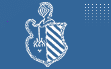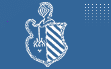Le mot du président
La
Divine proportion
Vous
avez lu «Da Vinci Code»? Vous savez donc de quoi je
parle : « le nombre d’or », « la pensée
du créateur » !
Quant
à celles et ceux qui n’ont pas encore été
initiés dans la… Fraternité, rassurez-vous :
je vous en livre le secret, c’est une « proportion »
que l’on retrouve partout dans la nature : 1,618.
Maintenant
que vous connaissez le secret, il vous suffira, pour en respecter
la beauté, d’ajouter 21,00 $ de don à votre
cotisation de 35,00 $. La « divine proportion » entre
35,00 $ et 21,00 $ : 1,6 ! Leonardo Da Vinci n’a pas fait
mieux.
Nous en reparlerons à la Fête annuelle, le lundi 25
avril prochain.
Le
Président,
Émile
Robichaud
Les
Jésuites des Montagnes Rocheuses
Notre
collègue Paul Vilandré, C. 59, nous écrit de
la région de St. Maries en Idaho, pour nous demander des
« détails sur le Père Nicolas Point s. j. et
le Père Pierre De Smet s. j., tous deux de Montréal,
et qui étaient responsables aux années 1840-1850,
des missions par ici, spécifiquement au Village St. Maries
auprès de la tribu Cœur d'Alène, tout près
de ma nouvelle demeure ».
Cette
requête en provenance d’un ancien, habitant un village
situé de l’autre côté des Rocheuses, portant
de surcroît le nom (modifié) du collège, soulève
beaucoup d’intérêt de ce côté-ci
des Rocheuses, mais… les pères De Smet et Point, qui
ont évangélisé les autochtones des tribus Cœur
d’Alène et Pend d’oreille, n’étaient
pas de Montréal. Les lignes qui suivent relatent les hauts
fait des ces deux Jésuites des Montagnes Rocheuses.
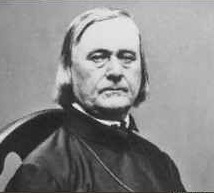
Le
père De Smet.
Pierre-Jean De Smet, naît
en 1801 dans ce qui allait plus tard devenir la Belgique. Inspiré
par les récits d’un missionnaire belge revenu du Kentucky,
il émigre aux États-Unis et fait son noviciat à
Baltimore. En 1823, il fait partie d’un groupe de novices
appelés par l’évêque de la Nouvelle-Orléans,
Mgr Dubourg, à établir une mission à Florissant,
village situé à l’embouchure du Missouri, près
de Saint-Louis. C’est là qu’il est ordonné
prêtre en 1827. En plus du ministère auprès
des indiens Osages, il contribue à la fondation du collège
de Saint-Louis où il enseigne la religion, l’anglais
et l’agriculture pour ensuite devenir procurateur et préfet
des études. Le collège de Saint-Louis deviendra université
en 1832.
Le Père De Smet
reviendra chez les siens en Belgique pour recueillir des fonds au
bénéfice de l’Université Saint-Louis
mais, pour diverses raisons, il ne retourne aux États-Unis
qu’après quatre années. Entre-temps, la ville
de Saint-Louis s’est rapidement développée et
le jésuite exercera dorénavant son ministère
plus loin à l’ouest auprès des ces quelques
200 000 autochtones que le gouvernement américain a déportés
à l’ouest du Mississipi, pour faire place à
la « civilisation ». Ces transferts massifs de populations
bouleversent les communautés autochtones, entraînent
des conflits, et le père De Smet trouve largement de quoi
mettre à profit ses talents de conciliateur et de négociateur.
Nous sommes en 1838 et le père De Smet se rend à Council
Bluffs (Omaha) sur le Missouri, près de l’embouchure
de la rivière Platte, où il devient le pasteur des
Potawatomis, que le gouvernement américain a chassés
de leurs territoires de l’Illinois et de l’Indiana..
En 1839, deux autochtones
de la tribu des Têtes-Plates, Pierre Gaucher et Ignace La
Mousse, traversent les Rocheuses à destination de Saint-Louis
afin d’obtenir une « Robe Noire » pour leur communauté.
Leur demande sera agréée et c’est le père
De Smet qui sera mandaté l’année suivante pour
aller servir les communautés autochtones au-delà des
Rocheuses.
En 1841, le père
De Smet fonde la mission de Sainte-Marie, sur la rivière
Bitterroot, un affluent du fleuve Columbia, pour desservir la tribu
des Têtes-Plates. D’autres missions seront créées
sous son autorité dans la région par les jésuites
Huet et Point, parmi les « Cœur d’alène
» et les « Pend d’oreille ».
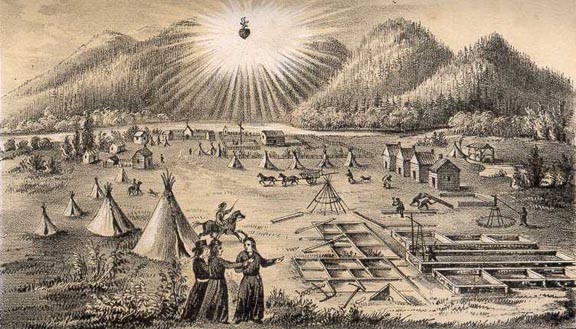
Fondation
de la mission Sainte-Marie.
Ces missions se situent à l’intérieur
du vaste territoire de l’Oregon, qui s’étendait
alors de la Californie jusqu’à la limite sud de la
colonie russe de l’Alaska. En attendant de pouvoir s’entendre
sur le tracé d’une frontière, l’Angleterre
et les États-Unis avaient convenu en 1818 de faire provisoirement
de cette région au-delà des Rocheuses une zone ouverte
aux citoyens des deux pays. Cette entente allait permettre à
la Compagnie de la baie d’Hudson de renforcer ses activités
de traite des fourrures dans la vallée du fleuve Columbia,
avec le concours des voyageurs
« canadiens »
et « iroquois » qui s’étaient établis
le long des affluents du Columbia et avaient donné des noms
français à plusieurs sites de la région. Recrutés
au départ par la Compagnie du Nord-Ouest et la Pacific Fur
Company, ces voyageurs étaient devenus les premiers colons
de l’Oregon.
Des ecclésiastiques
canadiens tels les pères Blanchet, Bolduc et Demers vinrent
à cette époque exercer leur ministère dans
l’Oregon à l’invitation de la Compagnie de la
baie d’Hudson, mais ils desservaient surtout les zones basses,
plus près du Pacifique ; de plus et ils n’étaient
pas jésuites.
De Smet restera dans l’Oregon
jusqu’à sa mort en 1873. À l’hiver 1845-46
il séjournera dans ce qui n’était pas encore
le Canada, dans la région d’Edmonton et Jasper, pour
parlementer avec les Pieds-Noirs souvent en conflit avec les Têtes-Plates.
Ce sera la seule fois qu’il viendra au Canada, à part
un bref séjour à Halifax.
Si De Smet a été
le fondateur des missions de l’Idaho, sa renommée tient
beaucoup également à son important rôle de négociateur
entre le gouvernement américain et les tribus de l’Ouest,
ce qui a permis d'éviter de grandes effusions de sang.
Nicolas
Point
Nicolas Point naquit à
Rocroy, dans le Nord de la France en 1799. Il entra chez les Jésuites
en 1819 à Saint Acheul et y exerça son ministère,
pour ensuite être affecté à Fribourg (Suisse)
puis à San Sebastian, en Espagne, où il fut vice-recteur
du collège Saint-Roch. Les Jésuites étaient
à cette époque l’objet d’une forte opposition
dans une Europe où régnaient les idées libérales
; lorsqu’ils furent expulsés d’Espagne en 1834,
les supérieurs de Nicolas Point l’envoyèrent
en Amérique et il débarqua à New York en 1835.
D’abord affecté à l’école St. Marys,
au Kentucky, il travailla ensuite à la construction du collège
Saint-Charles, à Grand Coteau en Louisiane et fut affecté
en 1840 à Saint-Louis où il rencontra le Père
De Smet.
Il accompagna De Smet dans son voyage
de 1840 dans les Rocheuses et il s’y établit pour instruire
les tribus Têtes Plates et Cœur d’Alène.
Il écrit alors un journal de ses activités et surtout,
il réalisera de saisissants croquis de la vie et des mœurs
de ces Amérindiens. Vers la fin de sa vie, il souhaita vivre
dans un milieu où il aurait plus d'occasions de parler français,
et c’est ainsi qu’il fut affecté en 1859 au noviciat
du Sault-au-Récollet, sur l’île de Montréal.
Il y rédigea un récit de sa vie, intitulé
Souvenirs des Montagnes Rocheuses. Le père Point mourut
à Québec en 1868.
Le rôle important que jouèrent
les Jésuites au Canada nous fait quelquefois oublier leur
rayonnement dans plusieurs régions des États-Unis,
où ils ont été présents depuis le début
du XVIIe siècle. La question de notre confrère Vilandré
nous donne l’occasion de nous le rappeler.
N. B. : Cet article est basé pour l’essentiel sur le
site WEB suivant consacré au Père De Smet :
http://users.skynet.be/pater.de.smet/pj-f/pagina1.htm
Richard L’Heureux, C. 62
Remonter
En
bref
Les jumeaux Gilles
et Paul Dufault, C. 61, nous ont transmis la note suivante.
« Ils sont tous deux « doyens », dans leurs domaines
respectifs. Gilles, actuel directeur général du Centre
de la santé et des services sociaux du Vieux Longueuil et
de Lajemmerais, incluant le Centre hospitalier Pierre-Boucher, trois
CLSC, huit CHSLD ainsi qu’une multitude de points de service,
est directeur général dans le secteur de la santé
et des services sociaux depuis 1972. C’est un record québécois
de longévité à ce poste. Il fait également
partie du personnel enseignant de la faculté de médecine
de l’Université de Montréal. Paul, actuel commissaire
à la Commission des relations du travail du Québec,
est juge administratif depuis 1978. @
Loin mais fidèle…
Paul Vilandré, C. 59, vient de renouveler sa cotisation pour
trois ans, en ajoutant un don pour la continuité de l’Association.
Établi en Californie depuis une trentaine d’années,
Paul a fait le voyage pour participer aux retrouvailles de ses confrères
du conventum 59 en décembre 2001 ! L’éloignement
ne l’empêche pas de garder le contact. Après
une maîtrise en administration à Harvard, Paul a fait
carrière dans la Silicon Valley notamment dans le domaine
des communications sans fil ! Bravo, Paul, de rester fidèle
malgré l’éloignement. @
Soirée
bénéfice bénéfice pour le Théâtre
Longue Vue 2. Voici les noms des cinq gagnants d'une paire
de billets pour cet événement qui a eu lieu au Gesù
le 18 novembre 2004 : Jean-Jules Guilbault, C. 50, André
Boudrias, C. 59, J. Robert Leroux, C. 63, André Bailly, C.
64 et Daniel Alain Dagenais, C. 68. La soirée comportait
la présentation du Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux.
Remonter
Passons
sur l'autre rive (Marc 3,35)
Errata : Dans le numéro précédent, nous
avons annoncé par erreur le décès de Jean-Guy
Nadeau, C. 48 ; nous en sommes vraiment désolés. De
plus, Jean Désormeaux n'était pas optométriste,
mais technicien de laboratoire et il appartenait au conventum 47,
non pas au conventum 48.
Jean Chapdeleine,
C. 31, haut fonctionnaire du gouvernement du Canada et
du Québec, décédé à Québec
le 1er février 2005. Il a été tour à
tour ambassadeur du Canada en France (1956-1965) puis délégué
général du Québec à Paris (1965-1976).
Il a terminé en 1981 sa carrière au ministère
des Affaires intergouvernementales du Québec. On lui a attribué
les titres de Commandeur de la Légion d'honneur, d'Officier
de l'Ordre national du Québec et d'Officier de l'Ordre de
la Pléiade. L'ancien ministre Gilles Loiselle l'a qualifié
de « père de la diplomatie québécoise
contemporaine.»
Antoine Bonin,
C. 35, décédé à Granby le 10
octobre 2004.
Paul-Émile
Papillon, s. j., C.35, décédé à
Saint-Jérôme le 31 janvier 2005. Il entra chez les
jésuites en 1937 et fut ordonné prêtre en 1949.
Il a occupé les fonctions de supérieur du noviciat
des jésuites (1951-1958), de supérieur de la villa
Saint-René-Goupil et d'assistant du supérieur du collège
de l'Immaculée Conception (1964-2000).
Ernest Cartier,
C. 37, courtier en assurances, décédé
à Montréal le 21 septembre 2004.
Marcel Arseneault,
C. 38, capitaine d'artillerie, décédé
en 2004 à … le …
Gérard
Saint-Denis, C. 38, publicitaire, décédé
à Montréal le 22 septembre 2004. Il travailla pendant
41 ans dans diverses agences de publicité, étant l'un
des pionniers de la publicité en langue française.
Après sa retraite en 1979, il consacra son expérience
de publicité et de marketing à des organismes communautaires,
notamment l'Institut national du Canada pour les aveugles et la
Société Saint-Vincent-de-Paul. Son ardent travail
de bénévole lui a valu, en 1993, de recevoir du Gouverneur
général du Canada la médaille commémorative
de la Confédération.
Pierre C. Grothé,
C. 40, ingénieur et professeur à l'École
Polytechnique, décédé à Outremont le
31 octobre 2004.
Gaëtan Lemire,
C, 41, médecin chirurgien, décédé
à Le Gardeur le 5 janvier 2005. Le docteur Lemire a exercé
sa profession pendant 27 ans à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie.
Remi Potvin, s.
j., C. 41, décédé à Saint-Jérôme
le 26 novembre 2004. Entré chez les jésuites en 1945,
il a été ordonné prêtre en 1955. Il a
enseigné au collège Saint-Ignace pendant sa régence.
Par la suite, il occupa les postes suivants : assistant du maître
des novices 1959-1962), maître des novices (1962-1968), supérieur
de la maison Bellarmin (1973-1976) puis de la villa Saint-René-Goupil
à Longueuil (1976-1984) et enfin du centre Vimont à
Montréal (1986-1991). De 1991 à 1997, il a été
assistant du Provincial des Jésuites.
Angelo Kakos,
C. 43, médecin, décédé à
Boucherville le 24 janvier 2005.
Arthur Poirier,
C. 44, administrateur scolaire, décédé
à Lachine le 2 janvier 2005.
Jean-Charles Paquette,
C. 45, technicien de laboratoire, décédé
à Fabreville le 29 septembre 2004. Il a été
assistant de recherche puis chef du laboratoire BCG à l'Institut
Armand-Frappier de Montréal.
Bruno Lavigne,
C. 46, optométriste, décédé
à Beloeil le 18 décembre 2004.
Yves Mayrand,
C.49, médecin, décédé à
Laval le 20 décembre 2004.
Maurice L'Écuyer,
C. 51, médecin orthopédiste, décédé
à Richmond, Texas, le 28 décembre 2004.
Jean Gaudry, C.
53, propriétaire d'une concession d'automobiles,
décédé à Stuart en Floride le 25 janvier
2005.
Marcel Laperrière,
C. 56, prêtre à la retraite, décédé
à Montréal le 3 février 2005.
Remonter
|