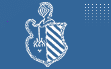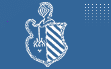Le
mot du président
Et l’humanisme ?
Le ministre de l’Éducation du Québec l’avoue
: il ne comprend rien aux bulletins de ses enfants !
Triste dérive d’une éducation nationale qui
a voulu faire table rase des acquis. Pourtant, il existe une pratique
pédagogique qui a subi l’épreuve du temps, celle
qui nous a formés : l’humanisme.
Je vous livre mes réflexions à ce propos dans le
présent bulletin, réflexions nourries par près
de cinquante ans de métier.
Le président,
Emile Robichaud C.53
FÊTE
ANNUELLE DES ANCIENS
Le lundi 24 avril 2006
Au Gésù
1202, rue de Bleury à Montréal
La tendance se maintient… À cause de la diponibilité
des salles au Gésù, il semble que la fête annuelle
des anciens soit fixée pour de bon au dernier lundi d’avril.
Inscrivez donc ce rendez-vous à votre agenda et invitez d’autres
membres de votre conventum à se joindre à vous.
Programme
Remonter
Vie des conventums
N.D.L.R. Sauf indication contraire, les personnes apparaissant
sur les photos sont identifiées de gauche à droite.
On trouvera généralement dans le site Internet de
l’Association un compte rendu plus élaboré de
ces rencontres et des photos en plus grand nombre.
Après un sommet de six rencontres en 2004, les réunions
de conventum marquent une pause en 2005 avec deux rencontres, soit
celles des conventums de 1945 et de 1959. Pour le conventum de 1950,
dont la réunion quinquennale se serait normalement tenue
à l’automne, cette rencontre est simplement remise
au printemps.
Conventum 1945
Le conventum 1945 se réunissait le 15 novembre dernier,
regroupant six de ses membres les plus assidus: Jacques Beauchamp,
le Père Guy Demers, s.j., Maurice Joubert, Claude Leduc,
Pierre Loyer et Jean-Paul Ouellette.
La réunion s’est tenue au restaurant « Le bistro
gourmet » sur la rue St-Mathieu. Ce fut l’occasion pour
nos collègues de se remémorer leurs confrères
étudiants ainsi que les grands enseignants de l’époque
qui ont marqué plusieurs générations : Les
pères Maurice Vigneau, Bernard Taché, Georges-Henri
d’Auteuil, Clément Lamarche, et leur professeur de
mathématique Émile Gérard. Ils ont aussi eu
une bonne pensée quelqu’un qui jouait alors un rôle
souvent ingrat mais nécessaire, le préfet de discipline
Dorval Monty s.j.
Conventum 1959
Modèle de fidélité, le conventum 59 continue
de se réunir à chaque année. Comme le restaurant
Marché Mövenpick de la Place Ville-Marie, où
se sont tenues les quatre dernières retrouvailles annuelles
d’automne du conventum 59, a fermé ses portes, il fallait
trouver une formule tout aussi conviviale tout en respectant les
disponibilités pécuniaires de chacun…
Le 2 novembre 2005, Jacques
D. Girard a invité et reçu les confrères chez
lui pour l’apéro, après quoi nous nous sommes
retrouvés pour un souper dans un bon restaurant vietnamien
du quartier Notre-Dame-de-Grâce.
À la vingtaine de confrères présents, Jean
Ruest a communiqué les résultats d’un sondage
effectué en mars 1961 auprès d’élèves
du collège, dans le cadre d’un travail en sociologie
pour le professeur Jogues Girard.
La question posée comportait quatre choix de réponse.
Elle était suivie d’un espace d’une demi-page
pour la justification.
Êtes-vous en faveur…
- de l’annexion du Canada aux États-Unis : 4 %;
- de l’annexion du Canada français à un Canada
anglophone : 1 %;
- de l’indépendance du Canada français : 35
%;
- du statu quo (demeurer dans la situation actuelle)
: 60 %.
Les justifications ont permis de ventiler ainsi les réponses
du statu quo :
neutre : 22 %;
amélioré : 20 %;
favorable à plus d’indépendance : 18 %.
Donner brièvement les raisons de votre réponse.
Jean a lu, à ceux qui le souhaitaient, la réponse
et la justification qu’ils avaient données alors. Passionnant!
Parmi les commentaires, certains ont trouvé que nous n’étions
pas très «révolutionnaires» et d’autres,
que les opinions n’avaient pas beaucoup changé.
François Cousineau
se met alors au piano pour une ronde de refrains nostalgiques repris
en chœur. Il faudra insister pour que les confrères
quittent et se rendent au resto. Les retrouvailles de conventum
: un plaisir toujours renouvelé!
Bernard Downs
Conventum 1950
Préférant le printemps à l’automne,
le conventum 1950 se réunira le mardi 9 mai, à 18
:00 heures, au restaurant « Les infidèles »,
situé au 771, rue Rachel est. Pour plus de renseignements,
communiquer avec Gilles Lavigueur, 514 769 1805.
Remonter
Les lieutenants-gouverneurs
Gaspard Fauteux et Jean-Louis Roux au cœur de l’histoire
du Québec
Le vendredi deux décembre dernier, Madame
Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec, présidait
au lancement d’un très bel ouvrage intitulé
: L’Histoire du Québec à travers ses
lieutenants-gouverneurs. Elle avait invité à
cette impressionnante cérémonie des représentants
de toutes les institutions qui ont formé des lieutenants-gouverneurs
du Québec. Le président de votre association
y était, accompagné de son épouse. La
dédicace qu’a rédigée Madame Thibault
dans l’exemplaire qui était réservé
à l’Association des Anciens du Collège
dit l’essentiel :
«Monsieur Émile Robichaud
Comme président des Anciens
du Collège Sainte-Marie
où les lieutenants-gouverneurs
Gaspard Fauteux
Jean-Louis Roux
ont puisé valeurs et savoir»
Notre collègue Jean-Louis s’est excusé
de son absence, retenu qu’il était à Montréal
par son rôle dans Antigone, au Théâtre
du Nouveau-Monde.
La présentation officielle des représentants
de chacune de ces institutions était, en quelque sorte,
un rappel du rôle important qu’elles ont joué
dans l’histoire du Québec.
Décidément, la «grande noirceur»
n’était pas aussi noire que d’aucuns le
proclament.
Le président,
Émile Robichaud C. 53
|

M. Émile Robichaud,
Président de l’AACSM, l’Honorable Lise
Thibault,
Lieutenant-gouverneur du Québec,
Madame Cécile Robichaud |
Remonter
La pratique pédagogique
à l’épreuve du temps
Le temps, a dit un sage, se venge de ce qu’on fait sans lui
: les réformateurs de nos systèmes d’éducation
l’ont oublié. Leur légèreté nous
a transformés en Sisyphes, condamnés à remonter
à perpétuité le rocher des réformes.
Le temps…
Le temps que l’homme prend pour s’arrêter, pour
réfléchir, pour observer en lui et autour de lui le
travail de la Vie et en transmettre l’essentiel à ceux
qui viennent après lui : la vie, la pensée, la culture…
Le temps que l’homme façonne : l’histoire…
Définir ainsi le temps, c’est reconnaître à
l’homme une liberté, un accès, à l’universel
que lui ont refusés, sans le dire et, souvent même,
sans s’en rendre compte, une bonne partie des artisans des
réformes scolaires des quarante dernières années.
Le temps que l’homme prend…
La bousculade qui a présidé aux grandes réformes
de l’éducation n’est pas un accident de parcours
: il fallait faire vite, il fallait changer, tout changer pour suivre
le cours de l’histoire devenue porteuse du salut
: l’histoire avait assumé le rôle de Dieu ! Et
ce dieu exigeant ne souffrait pas que l’on résistât
au premier de ses commandements : le progrès. Prendre le
temps de réfléchir, de mesurer l’impact des
changements, c’eût été, en quelque sorte,
pécher contre l’esprit du progrès, le seul
péché qui ne sera pas pardonné.
Ainsi imprégnés d’historicisme, les réformateurs
se sont lancés, tête première… en avant
: il fallait, selon l’expression reçue, aller de
l’avant : pas question, surtout de revenir en arrière.
C’est ainsi que le progrès s’est trouvé
figé dans un monde à deux dimensions : l’avant
et l’après. Il n’y avait plus de progrès
que linéaire et tout ce qui appartenait au passé était…
dépassé. Cela valait pour les manuels, pour les programmes,
pour les méthodologies, pour les maisons d’éducation
et pour les philosophies de l’éducation.
Tout cela procède, aussi, d’une véritable révolution
dans l’ordre de la pensée : dans cette vision matérialiste,
structuraliste du monde, «L’homme meurt comme sujet
autonome et devient le champ d’action de forces ou de structures
qui échappent à son appréhension consciente.»1
Il lui faut donc se soumettre au déroulement de l’histoire
et en suivre le cours le plus fidèlement possible.
Il n’y a plus de vérités permanentes, d’invariants
qui échappent aux temps. Il n’y a de réel (et
d’utile) que l’actuel.
La pratique pédagogique contemporaine est imprégnée
de cette conception de l’histoire et du rôle de l’homme
dans l’histoire.
L’obsession du changement a pris la place de la recherche
du sens.
Il faut voir, entre autres, les tableaux comparatifs que les technocrates
utilisent pour vendre le progrès. Ainsi, autrefois
les enseignants se limitaient aux connaissances : à l’avenir,
enfin, ils s’occuperont, grâce aux nouveaux programmes,
des habiletés ! Et, bien sûr, résultera,
de tout cela, une évaluation différente :
car évaluer une habileté, c’est évaluer
si un élève a intégré des connaissances
dans la pratique.
Vous aurez beau rappeler qu’une dictée, qu’une
version latine, qu’un problème d’algèbre
n’ont jamais été autre chose que l’évaluation
de l’intégration des connaissances dans la pratique,
rien n’y fait : la loi du progrès exige que chacune
des institutions consacre des sommes d’argent énormes
à l’achat de nouveaux manuels conformes aux
exigences des nouveaux programmes eux-mêmes fidèles
à la nouvelle dialectique.
Pourtant la sagesse nous avait appris que «l’excès
dans la mise en œuvre se fait aux dépens de la recherche
du sens.»2 Mais cette recherche du sens exige que l’homme
prenne du temps…
Du temps pour réfléchir…
Du temps pour vivre avec la pensée…
Du temps pour partager, avec d’autres hommes qui ont vécu
avant lui et qui vivent en même temps que lui, le fruit de
ses réflexions.
Cette recherche du sens exige, surtout, que l’homme ne se
considère pas uniquement comme le produit de son temps mais
reconnaisse «l’aptitude de l’esprit à traverser
l’histoire sans s’abîmer complètement en
elle.»3
Le temps que l’homme façonne…
L’homme a laissé des traces dans sa longue traversée
de l’histoire. Des traces dans le langage qu’il a façonné
pour se saisir lui-même et pour saisir l’univers, pour
se dire à lui-même et dire aux autres le fruit de sa
longue observation de son monde intérieur et du monde qui
l’entoure. Langage aux multiples facettes et aux multiples
moyens, oeuvres passées au crible du temps et parvenues jusqu’à
nous pour nous rappeler que l’esprit humain est au cœur
de l’histoire et qu’il l’a traversée «sans
s’abîmer complètement en elle».
Comme ils sont beaux les mots bizarres, les mots exceptionnels
quand on les considère ainsi comme des traces de l’esprit
humain ! Et combien significative de l’esprit du temps que
cette volonté récemment proclamée de simplifier
la langue, de créer un nouveau français standard
épuré des fantaisies de l’esprit humain ! Volonté
de tout clarifier, de tout standardiser alors que «les
mots fixés, établis depuis très longtemps,
les mots qui avaient servi à des milliers d’existences
humaines, se chargeaient d’émotion, d’un voltage
considérable, qu’ils ont perdu.» Et Marguerite
Yourcenar d’ajouter : Il y a des domaines, comme la religion
ou la poésie, qui doivent rester obscurs ou éblouissants,
ce qui revient au même.»>4
L’éblouissement, cette troisième dimension
par laquelle l’esprit humain échappe au temps et marque,
aussi, le temps.
L’éducation, qui étouffe dans son pauvre monde
à deux dimensions, a grandement besoin d’éblouissement
car dans sa course folle, dans sa progression insensée,
il n’y a aucune recherche du sens.
Tout se passe comme si on avait oublié que l’âme
humaine est capax hominis, apte à saisir le sens
de la démarche humaine, au même titre que saint Augustin
disait que l’homme est capax Dei.
Au-delà du temps…
Quand nous aurons compris que «l’universalité
se situe dans la dimension de la profondeur et non dans l’extension,»5
quand il se trouvera un nombre raisonnable d‘éducateurs
qui croiront que nous pouvons «entrer en communion avec tout
le passé et ainsi nous arracher à l’étroitesse
de notre temporalité première et partager avec les
meilleurs esprits ces vérités magnifiques et éternelles»
(quae immensa, quae éterna sunt)6, alors, mais alors seulement,
l’éducation retrouvera un sens.
Nous cesserons de tout bousculer, de tout chambarder parce que
nous aurons enfin compris que «toute vérité
(…) ne s’offre pas à nous sous forme de parcelles
de métal natif à l’état pur, mais à
l’état d’alliage ou de combinaison avec une réalité
humaine.» 7
Et nous retrouverons le respect des grands maîtres et des
grandes œuvres parce que, plutôt que de consacrer toutes
nos énergies à modifier l’apparence des choses,
nous en rechercherons le sens.
À la fin de ses Mémoires d’Hadrien,
Marguerite Yourcenar cite ce beau poème de l’empereur
:
Animula vagula, blandula…,
Petite âme, âme tendre et flottante,
compagne de mon corps, qui fut ton hôte,
tu vas descendre dans ces lieux pâles,
durs et nus, où tu devras renoncer
aux jeux d’autrefois. Un instant encore,
regardons ensemble les rives familières,
les objets que sans doute nous ne reverrons plus…
Tâchons d’entrer dans la mort les yeux ouverts…8
Mort en 138, l’empereur nous est, ô combien, contemporain.
Entre son dialogue intérieur avec sa petite âme,
tendre et flottante et la méditation d’Allan Bloom
sur l’Âme désarmée, dix-huit
siècles et demi se sont écoulés…
Non, l’esprit de l’homme ne s’est pas complètement
abîmé dans l’histoire…
Quae aeterna quae immensa sunt…
Emile Robichaud C. 53
1 FINKIELKRAUT, Alain, La défaite de la
pensée, Paris, Gallimard, 1987, p. 80.
2 DUFRESNE, Jacques, La Reproduction humaine industrialisée,
I.Q.R.C., Québec, 1986, p. 88.
3 INKIELKRAUT, Alain, ibid, p. 124.
4 OURCENAR, Marguerite, Les Yeux ouverts, Paris, Le Centurion, 1980.
5 MARCEL, Gabriel, Les hommes contre l’humain, Paris, Éditions
du Vieux Colombier, 1951, p. 202.
6 SÉNEQUE, De brevitate vitae 14, 1-2.
7 MARROU, Henri-Irénée, De la connaissance historique,
Paris, Seuil, 1954.
8 YOURCENAR, Marguerite, Mémoires d’Hadrien, Paris,
Plon, 1951, p. 423.
Remonter
Les
anciens publient…
La chronique “Les anciens publient” paraît ordinairement
dans le bulletin qui suit le Salon du livre de Montréal et
se base sur un recensement paraissant dans le programme du Salon.
Nous y ajoutons d’autres publications quand nous en sommes
informés mais nous réalisons bien que notre liste
n’est pas complète
Francine ALLARD, C. 68, Mon royaume pour un biscuit, aux
éditions Hurtubise HMH.
Pierre CAMU, c. 42, Le Saint-Laurent et les Grands Lacs,
aux éditions Hurtubise HMH.
Pierre DANSEREAU, C. 29, LA LANCÉE, chez Multimondes. Il
s’agit du premier tome de l’autobiographie du grand
environnementaliste, couvrant les années 1911 à 1936.
Marcel DUBÉ, C. 49, ANDRÉ PITRE, aux éditions
Art Global.
Jérôme ÉLIE, élève au collège
de 1956 à 1961, L’ESTRANGE DANS SA NUIT, aux éditions
de la Pleine Lune.
Laurent LAPLANTE, ancien professeur de Méthode au collège,
JE N’ENTENDS PLUS QUE TON SILENCE, aux éditions JCL.
Remonter
Suggestion
pour une bonne action
Au cours de l'année 2005, j'ai eu le bonheur de rendre visite
au père Gérard Delisle en deux occasions à
la résidence des jésuites à Saint-Jérôme.
La première fois, c'était avec un vieux copain des
années cinquante, François Trépanier, qui fut
élève au collège de 1949 â 1952, soit
des Éléments français à la Méthode.
Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'arrivais en Éléments
latins. Et notre premier souvenir commun (il y en a eu des milliers
depuis, d'autant plus que nous avons été collègues
à LA PRESSE et que nous nous sommes mariés le même
jour, en 1962...), ce fut une baignade au cap Saint-Jacques, organisée
par le père Delisle.
Notre intention commune ce jour-là de février, c'était
d'amener le père Delisle luncher au restaurant. Pas question,
dit-il (d'autant plus que ses vieilles jambes compliquent ses déplacements!)
Nous étions ses hôtes, et c'est lui qui nous invitait
à prendre le repas à la résidence des jésuites.
Durant le repas, le père Laval Girard s'est joint à
nous, décuplant ainsi le plaisir que me procurait cette visite.
Nous avons passé environ trois heures en sa compagnie, à
ressasser de vieux souvenirs de cette incroyable maison d'institution
et de formation personnelle qu'était le collège Sainte-Marie.
Les yeux du père Delisle pétillaient de plaisir. Il
n'avait pas besoin de nous dire à quel point il était
heureux, ça se devinait tellement facilement.
J'y suis retourné en novembre, cette fois avec ma femme
Martha et mon frère Gilles, avec des résultats semblables,
quoique les souvenirs qu'on a partagés prenaient évidemment
une autre dimension, tant avec mon épouse qu'avec mon frère,
lui-même élève au collège.
Je reconnais que le préambule est démesurément
long pour en arriver à la suggestion que je veux vous proposer,
et qui se résumera en quelques lignes.
Si vous avez du temps libre, et si les déplacements en voiture
ne vous sont pas trop pénibles, et si, en second lieu, vous
connaissez un ancien professeur du collège qui vit sa retraite
à la résidence de Saint-Jérôme, trouvez
le moyen de lui rendre visite. C'est une marque de gratitude qui
fait grandement plaisir, et qui vous réchauffe le coeur.
Et je vous garantis que tant à l'aller qu'au retour, pendant
le voyage en voiture, le collège Sainte-Marie occupera toute
la place dans vos réflexions. Quel bonheur!
Guy Pinard C. 57
Remonter
Henri
Tranquille 1916 – 2005 : Témoignage d’un jeune
collégien
Nous sommes en 1947. Un jeune collégien quitte le Couvent
des Sœurs de la Providence, coin Ste-Catherine et St-Hubert.
Il y sert la messe tous les matins et en retour, les bonnes Religieuses
lui assurent le vivre et le couvert.
Il s’achemine vers le Collège Ste-Marie où
il fait ses études classiques.
Il ne peut s’empêcher d’entrer à la Librairie
Tranquille, 87 ouest rue Ste-Catherine, tél. : BE 6571. Derrière
un comptoir surchargé de livres, surgit un Monsieur.
« Qu’est-ce que je peux faire pour toi mon garçon?»
C’était mon premier contact avec Henri Tranquille.
« J’aime beaucoup lire Monsieur; je suis un collégien
du Ste-Marie, mais pas très riche…Que me conseillez-vous?»
J’avais 16 ans! Il m’amène devant une étagère
où règne la Collection Nelson, livres de poche du
temps.
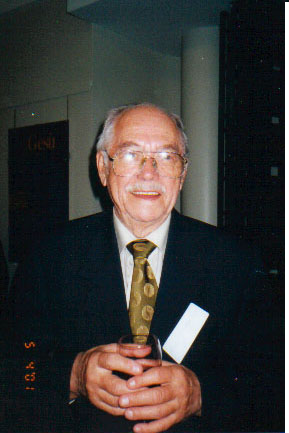 «
J’ai ici quelque chose qui devrait t’intéresser
: le Comte de Monté-Cristo d’Alexandre Dumas, en 6
volumes.» «
J’ai ici quelque chose qui devrait t’intéresser
: le Comte de Monté-Cristo d’Alexandre Dumas, en 6
volumes.»
« Combien?
- Je te laisserais ça à 40 cents du volume.
- 4 fois 6 égale 2,40$! Ouf! Je suis intéressé,
mais ne dispose pas d’une pareille somme!
- Tu m’as l’air d’un jeune homme honnête;
je vais faire un marché avec toi; je te vends le premier
volume et je te garde les autres. Tu peux venir les chercher quand
tu voudras.»
Ce fut notre première entente, mais non la dernière.
J’ai encore, à l’âge de 75 ans, une soixantaine
de volumes de la Collection Nelson dans ma bibliothèque :
Alphonse Daudet, Charles Dickens, les Pensées de Pascal et
même l’Introduction à la vie dévote de
Saint-François-de-Sales…« Il faut varier tes
lectures…» , me disait-il en riant.
Et puis la vie nous a séparés. J’ai eu le bonheur
de le revoir en 2001, à l’occasion d’une rencontre
des Anciens du Ste-Marie. Nous avons échangé. Il n’avait
pas changé…toujours rieur et doté d’une
mémoire extraordinaire.
Il est décédé le 20 novembre 2005, à
l’âge de 89 ans…
Merci Henri pour tout ce que tu m’as donné et que
j’ai transmis à des milliers d’étudiants
pendant mes 32 ans d’enseignement.
En 2006, j’ai toujours un livre à lire sur ma table
de chevet et ce goût de la lecture, c’est toi qui me
l’a donné…
Léo Côté, C.50
Remonter
En
bref
Jacques R. Roy, C. 57, est devenu le 4 novembre 2005, le trente-sixième
président de la Conférence des juges du Québec
qui regroupe les juges des trois Chambres de la cour du Québec:
Chambre civile, Criminelle et pénale et Jeunesse ainsi que
les juges des Cours municipales de Montréal, Québec
et Laval.
La revue Relations publiée par les Jésuites depuis
1941 continue de susciter la réflexion sur les grands enjeux
de notre temps. Le numéro de janvier-février 2006
présente un dossier intitulé « à la rencontre
de l’islam ». Celui de mars-avril est consacré
aux luttres des femmes dans les pays du Sud. Pour en savoir plus,
consulter le site de la revue : www.revuerelations.qc.ca.
Remonter
Le collège Sainte-Marie
et ses parrains politiques.
Nous connaissons bien le rôle du père Félix
Martin S.J. comme fondateur du collège Sainte-Marie, et tout
ce qu’il a fait pour son développement. Non seulement
en était-il le fondateur, mais il en fut même au départ
le propriétaire, ayant acheté en 1846 le terrain Donegani
où devait être construit le collège.
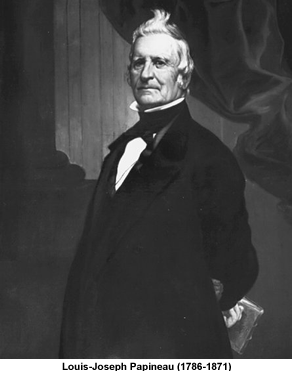 Mais
pour fonctionner normalement, le collège devait être
doté du statut juridique que donne l’incorporation
et celle-ci devait être votée en chambre par les représentants
du peuple. Nous sommes à l’époque du Canada-Uni,
plus de dix après qu’une loi du Parlement britannique
ait réuni les deux chambres du Bas et du Haut Canada. La
création d’une institution d’enseignement secondaire
dirigée par les Jésuites au départ n’allait
pas de soi. Les tensions sont encore vives entre les communautés
après que des émeutiers aient mis le feu au Parlement
à Montréal pour protester contre la loi indemnisant
ceux qui avaient subi des dommages lors de la rébellion de
1837-38. Il fallait vaincre l’opposition de nombreux députés
anti-catholiques orangistes et autres qui redoutaient l’influence
du clergé. Mais
pour fonctionner normalement, le collège devait être
doté du statut juridique que donne l’incorporation
et celle-ci devait être votée en chambre par les représentants
du peuple. Nous sommes à l’époque du Canada-Uni,
plus de dix après qu’une loi du Parlement britannique
ait réuni les deux chambres du Bas et du Haut Canada. La
création d’une institution d’enseignement secondaire
dirigée par les Jésuites au départ n’allait
pas de soi. Les tensions sont encore vives entre les communautés
après que des émeutiers aient mis le feu au Parlement
à Montréal pour protester contre la loi indemnisant
ceux qui avaient subi des dommages lors de la rébellion de
1837-38. Il fallait vaincre l’opposition de nombreux députés
anti-catholiques orangistes et autres qui redoutaient l’influence
du clergé.
Le projet de loi incorporant le collège Sainte-Marie fut
présenté à l’assemblée du Canada-Uni
en août 1852 par John Young, député de Montréal
et commissaire des Travaux publics, homme d’affaires aux nombreuses
réalisations dont la moindre n’est pas la construction
du port de Montréal. On s’étonnera peut-être
qu’un député né en Écosse, de
foi protestante propose la loi d’incorporation d’une
institution catholique et française telle que le collège
Sainte-Marie. Il faut savoir que le collège est situé
à l’intérieur des limites de son comté.
Ensuite, tout français qu’il soit par sa direction
et ses méthodes d’éducation, le collège
ouvrait alors ses classes aux élèves de langue anglaise
autant que de langue française. Le projet de loi d’incorporation
du collège Sainte-Marie est présenté en première
lecture le 27 août 1852.
Le débat sur le projet de loi aura lieu lors de la deuxième
lecture du projet de loi, le 16 octobre 1852, et donne lieu à
des prises de position fort révélatrices. George Brown,
député indépendant très influent dans
le Haut-Canada, s’opposa avec force à l’incorporation
du collège Sainte-Marie, invoquant la présentation
imminente d’une loi-cadre devant régir l’ensemble
des institutions d’éducation et de charité.
En fait, Brown était opposé aux institutions «
séparées » françaises et catholiques,
qu’il fustigeait dans son journal The Globe. George-Étienne
Cartier pour sa part, adopte une attitude plus ambiguë, disant
(en se référant à Brown) qu’« il
n’aime pas les hypocrites, qu’ils soient Jésuites,
Baptistes ou Free churchmen »…. Il n’en appuie
pas moins le projet de M. Young (Journal de Québec, 16 octobre
1852). D’autres députés, comme Joseph Cauchon,
se prononceront sans réserve en faveur du projet d’incorporation
du Collège Sainte-Marie.
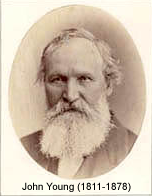 Mais
celui qui défendra avec le plus de conviction l’incorporation
du collège des Jésuites sera l’ancien chef du
Parti canadien devenu Parti patriote, un tribun agnostique qui refusera
les sacrements jusque sur son lit de mort : Louis-Joseph Papineau.
Il n’est pas resté de texte de son discours, mais les
journaux de l’époque relateront qu’il fit un
fort vibrant éloge des institutions d’éducation
du Bas-Canada. Mais
celui qui défendra avec le plus de conviction l’incorporation
du collège des Jésuites sera l’ancien chef du
Parti canadien devenu Parti patriote, un tribun agnostique qui refusera
les sacrements jusque sur son lit de mort : Louis-Joseph Papineau.
Il n’est pas resté de texte de son discours, mais les
journaux de l’époque relateront qu’il fit un
fort vibrant éloge des institutions d’éducation
du Bas-Canada.
L’incorporation du collège Sainte-Marie fut votée
en troisième lecture et reçut la sanction royale le
10 novembre 1852.
Trente-sept ans plus tard, soit en 1889, le premier ministre John
A. MacDonald se félicitait de ce que l’Assemblée
du Canada-Uni ait adopté par une forte majorité la
loi d’incorporation du collège Sainte-Marie et déclarait
: « J’ai voté cette loi…et je n’ai
pas encore eu l’occasion de le regretter. Cette institution
a continué son œuvre utile. Nous n’entendons pas
formuler une seule plainte au sujet de son enseignement, nous n’entendons
pas dire qu’elle pervertit la jeunesse, qu’elle enseigne
des doctrines déloyales ou des doctrines de nature à
jeter le discrédit sur le collège. Nous entendons
dire, au contraire, que cette institution a continué, et
continue encore à sa mission, qu’elle remplit avec
succès. »
Richard L’Heureux, C. 62
Sources : Journal de Québec, 16 octobre 1852, Desjardins,
Paul, S.J. : Le Collège Sainte-Marie de Montréal –
La Fondation, Le Fondateur, Collège Sainte-Marie, Montréal
1940.
Remonter
Passons sur l'autre rive (Marc
3,35)
Jean Laramée, s.j., C. 23, décédé
à Saint-Jérôme, le 17 janvier 2006. Entré
chez les Jésuites en 1923. Il avait étérecteur
du collège Brébeuf de 1942 à 1947.
Roger Larose, C. 27, ancien doyen de la Faculté
de Pharmacie et Vice-doyen de l’Université de Montréal,
décédé le 6 novembre 2005.
Pierre Angers s.j., C. 29, décédé
à Saint-Jérôme en janvier 2006. Il avait été
professeur au collège.
Roger Charland, C. 30, ingénieur, décédé
à Montréal le 8 décembre 2005.
Henri Tranquille, C. 36, libraire, décédé
à Montréal le 20 novembre 2005.
Roger Bordeleau, C. 37, optométriste, décédé
à Montréal le 23 janvier 2006. Il était le
père de Daniel Bordeleau, C. 67.
François-J. Lessard, C. 38, courtier en
valeurs mobilières, décédé à
Montréal le 25 septembre 2005.
Gabriel Marcotte, c. 40, professeur à l’école
des Beaux-Arts de Montréal, décédé le
10 janvier 2005
Roderick Jodoin, C. 41, médecin, décédé
à Montréal le 3 janvier 2005.
Laurent-Robert Laporte, C. 41, prêtre, ancien
directeur de disciples d’Emmaüs, décédé
à Montréal le 25 novembre 2005.
René Reeves, C. 44, ingénieur, ancien
vice-président à Radio-Québec et professeur
de management à l’Université du Québec
à Gatineau, décédé à Montréal
le 2 octobre 2005.
André Labonté, C. 50, notaire, avocat,
ancien secrétaire de la Commission des droits de la personne
du Québec
J. G. Pierre Gauvin, C. 49, gestionnaire, décédé
à Ottawa le 12 décembre 2005.
François Hogue, C. 51, notaire, décédé
à Montréal le 3 décembre 2005.
Andé Paquin, C. 51, dessinateur et technicien
en architecture, décédé à St-Léonard
le 9 novembre 2005.
André-Marc Dauth, C. 54, notaire et professeur
à l’Université de Montréal, décédé
à Montréal le 30 septembre 2005.
Bertrand Malenfant, C. 57, décédé
en septembre 2005
Yves Jetté, C. 59, médecin, décédé
à Montréal le 2 juin 2005.
Noël Audet, écrivain et ancien professeur
de français au collège, décédé
à Saint-Mathieu-de-Beloeil le 29 décembre 2005.
Remonter
|