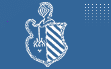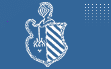Le
mot du Président
Le courage des deux regards
Dans une entrevue publiée dans Le Devoir en juin
dernier, l'abbé Pierre tenait ces propos : « Nous avons
deux yeux : un qui donne le courage de regarder le mal et de le
combattre, et l'autre qui veut que nous regardions ce qui est beau...
Ayons le courage de ces deux regards. »
Nos maîtres, jésuites et laïcs, ont voulu nous
donner le courage de ces deux regards. Car c'est bien de courage
qu'il s'agit. Ils nous ont appris à nous méfier de
la lâcheté qui se donne des allures de tolérance
et, pire encore, de sagesse ! À nous méfier, aussi,
de la tiédeur, cette moiteur de l'âme qui, comme toutes
les moiteurs, fait moisir tout ce qu'elle enveloppe.
Le Président
Émile Robichaud, C. 53
Remonter
En bref
La vie des conventums
Les réunions statutaires des conventums 49, 54, 59 et 64
sont inscrites au calendrier de l'année 2004. Le conventum
54 se réunit le jeudi 21 octobre au mess des officiers des
Fusilliers Mont-Royal, 3721 rue Henri-Julien, angle Duluth ; contacter
André Brossard, (514) 271-2959 ou a.brossard@sympatico.ca
. Quant aux membres du conventum 59, leur réunion se tiendra
à 17 heures le mercredi 17 novembre, au restaurant Mövenpick
de la place Ville-Marie ; renseignements : Jacques D. Girard, (514)
485-8114 ou jacquesd.girard@videotron.ca.
Par ailleurs, les « jeunes » du conventum 64 ont convenu
de se retrouver pour un souper le mardi 16 novembre dans les locaux
de la Banque de Montréal, sous la houlette de
L.-Jacques Ménard,
(514) 933-4546 ou jacques.menard@bmonb.com.
Hélas, rien ne semble bouger du côté du conventum
49…
D'autres groupes ont décidé, à cause du temps
qui passe si vite, d'augmenter la fréquence de leurs rencontres.
Ainsi, les gars du conventum 55 ont festoyé au restaurant
La Gaudriole le 13 septembre dernier et ceux du conventum 48 se
sont retrouvés au restaurant taverne Chez Magnan le 15 octobre.
Le prochain Bulletin accordera donc une place importante aux comptes
rendus de ces réjouissances.
À la mémoire
d'Émile Girard
Le 3 février dernier, le président Émile Robichaud
a adressé une lettre au recteur de l'UQÀM, M. Roch
Denis, pour réclamer que le nom d'Émile Gérard
soit redonné au pavillon des Sciences de l'UQÀM, rue
Saint-Alexandre. À l'origine, cette succursale portait le
nom du célèbre professeur de mathématiques,
et un buste le représentant aurait même été
installé dans l'entrée de ce pavillon. On a confirmé
que notre lettre avait été transmise au comité
de direction de l'UQÀM dès le 9 février, mais
aucune réponse ne nous est parvenue jusqu'à ce jour.
Au Gesù – Centre de créativité
Le Gesù vient de publier son programme d'activités
pour l'automne 2004. L'événement Art sacré
2004 se situe au cœur de cette programmation et il comprend
quatre volets : Arts de la scène, Arts visuels, Arts littéraires
et Conférences, ateliers, table ronde, regroupés sous
le thème « Le sacré, une expérience holistique
de création ». En plus des manifestations liées
à l'art sacré, chacun de ces quatre volets comprend
un grand nombre d'événements qui répondent
à des intérêts diversifiés. Soulignons
particulièrement une rétrospective du Frère
Jérome (15 septembre -13 octobre), un spectacle intimiste
de Serge Lama (22 septembre -3 octobre), la pièce de Marivaux
Les jeux de l'amour et du hasard, présentée
par la compagnie Longue Vue (2 novembre – 3 décembre),
des lectures d'œuvres littéraires et des rencontres
avec des écrivains (18 et 31 octobre, 15 novembre). En somme,
un bouquet bien garni d'activités intéressantes. Pour
en savoir plus, consultez le site Internet www.gesu.net
ou demandez un exemplaire du programme imprimé au (514) 861-4378.
Théâtre Longue Vue
Encore cette année, le Conseil d'administration a décidé
d'encourager cette compagnie qui fait la promotion du théâtre
classique auprès des jeunes et qui se produit chaque année
dans la salle du Gesù. L'objectif est aussi de récompenser
nos anciens qui payent fidèlement leur cotisation annuelle.
L'Association offrira donc cinq paires de billets pour le souper
bénéfice et la représentation spéciale
de Le Jeu de l'Amour et du Hasard, une comédie de
Pierre Carlet de Marivaux, le 18 novembre prochain au Gesù.
Le tirage au sort sera fait parmi les 482 membres en règle
au 15 2004.
Remonter
Propos sur l'éducation
Théories ... et pratique réflexive
J'emprunte, bien sûr, le titre de l'œuvre du philosophe
Alain pour désigner ces propos sur l'éducation annoncés
dans le numéro d'avril du Sainte-Marie.
Il ne s'agit ni de thèses
ni d'un argumentaire, mais de « propos » inspirés
par une longue carrière consacrée à l'éducation,
carrière qui se poursuit puisque, après trente-cinq
ans de service « public » – dont vingt-sept
à la direction d'école – me voici, depuis treize
ans, à la direction de l'Institut Marie-Guyart, école
universitaire de formation des maîtres (préscolaire
et primaire), liée par entente à l'Université
de Montréal.
J'ai toujours cru à la nécessité de la pratique
réflexive. On ne le répétera jamais assez :
la pédagogie est une pratique, à l'instar de la médecine,
du droit, du génie. Nous avons commis de graves erreurs en
éducation parce que nous avons oublié l'exigence fondamentale
de toute pratique professionnelle : la liberté d'action et
de décision des praticiens. Non pas qu'il faille négliger
la recherche : ce serait vouer la profession à l'asphyxie.
Mais le dernier mot dans toute pratique doit appartenir aux praticiens
: l'urgence d'un hôpital n'est pas sous la responsabilité
des chercheurs ! Leurs travaux enrichissent la pratique, mais ne
la dictent pas.
Pour le plus grand malheur de tout le monde, c'est ce qui s'est
passé en éducation. Les recherches essentielles n'ont
pas subi l'épreuve de l'expérimentation limitée
avant l'application généralisée de leurs hypothèses.
Mes « propos sur l'éducation » seront donc surtout
inspirés par une longue pratique réflexive qui a donné
lieu à plusieurs publications :
– Adolescents en détresse (Éditions
du Jour, 1968)
– Ce pour quoi il faut contester (Beauchemin, 1970)
– Les éducateurs sont-ils coupables ? (Beauchemin,
1971)
– Qui a peur de la liberté ? (publié
à compte d'auteur, 2000)
– Témoins au coeur du monde (collectif, Novalis
2003)
Il faudrait ajouter à cette liste de très nombreux
articles de revues.
Donc, une véritable pratique réflexive qui nourrira
les « propos » qui paraîtront dans les numéros
à venir du Sainte-Marie.
Émile Robichaud, C. 53
Remonter
« Écrivain, donne-moi du rum
! »
Le collégien devenu voyageur : Jean-Baptiste Perrault
(1760-1844)
Nos collèges classiques d’autrefois avaient la réputation
de former essentiellement des prêtres, médecins, avocats
et autres clercs, sans trop s’ouvrir aux autres professions
et métiers. Le cas du marchand voyageur Jean-Baptiste Perrault
constitue une exception à cette règle. Grâce
à l’éducation collégiale dont il bénéficiera,
ce natif de Trois-Rivières pourra, tout au long de sa carrière,
noter ses déplacements, transactions et observations. Au
soir de sa vie, il tirera de ses notes une autobiographie, qui est
l'un des rares témoignages sur la vie des voyageurs à
l’époque de la traite des fourrures.
Né en 1760 dans une famille de commerçants, Perrault
étudie au Collège de Québec de 1774 à
1782 [Perrault parle probablement du Séminaire de Québec].
Après ses études, il est plus attiré par la
traite des fourrures que par les professions auxquelles il aurait
pu prétendre. En mai 1783, il se joint pour une première
fois à une brigade de canots équipée par le
commerçant montréalais Marchessault, un ami de son
père. Le groupe rejoindra après plus de dix semaines
le village de Cahokia sur le Mississipi, en passant par l’Outaouais,
Michillimakinac et le lac Michigan. Perrault aime la vie qu’il
découvre, et ce contrat sera le premier d’une longue
série, toujours dans la région du Haut Mississipi.
Chaque fois, il prend des marchandises à Michillimakinac
et les transporte en canot, soit par le lac Michigan ou par le lac
Supérieur, jusqu’à un point de la région
du Haut Mississipi où lui et quelques collègues s’établissent
pour quelques mois, le temps de vendre ces objets aux Amérindiens,
contre des pelleteries.

En bas, à gauche, le fleuve Mississipi et au centre,
un peu vers la droite, le poste de traite de Michillimakinac.
Portion d'une carte des Grands Lacs réalisée en
1787 par l'ingénieur hydrographe Bonne, Bibliothèque
nationale du Québec.
« Écrivain, donne-nous du rum…», lui demande
un jour un Amérindien venu vendre ses peaux. Écrivain
sera le surnom que les Amérindiens donneront à Perrault,
comme aux autres qu’ils voyaient transcrire leurs transactions
et autres activités. Jean-Baptiste Perrault se distingue
aussi de ses co-voyageurs dans ses loisirs : pendant qu’eux
se détendent en jouant aux cartes, il lit le Télémaque
de Fénelon. Les voyageurs de l’époque
prenaient souvent femme dans le pays de la traite et y élevaient
leur famille. Perrault épousera aussi une Amérindienne,
mais il choisira, après quelques années, de l’envoyer
avec trois de ses enfants au sein de sa propre famille à
Rivière-du-Loup (devenue depuis Louiseville), pour «
les faire entrer dans le christianisme ». En 1805, il revient
pour une première fois en 22 ans à Rivière-du-Loup,
au chevet de son père gravement malade. Après le décès
de son père, c’est dans le Haut Saint-Maurice et dans
l’Outaouais qu’il fera des voyages de traite.
Toutefois, les gages versés dans ces régions peu
éloignées sont moindres que ceux qu’il gagnait
dans l’Ouest, et il décide en 1808 de devenir instituteur
à Saint-François, sur la rive opposée du lac
Saint-Pierre. Après deux années dans l’enseignement,
il se retrouve fort endetté et n’a d’autres ressources
que de se réengager pour l’Ouest, prenant à
nouveau congé de sa famille. Il fera la traite alors pendant
quelque temps au lac Supérieur et travaillera pour le compte
de la compagnie de la baie d’Hudson dans la région
de fort Albany, sur la baie James. De là, il conduit, toujours
en canot, un ex-gouverneur de poste de la compagnie de la baie d’Hudson
et sa famille vers Montréal. Il reprend alors le métier
d’instituteur à Saint-François pendant l’année
1814-1815, mais l’insuffisance des gages l’amène
encore une fois à se réengager comme charpentier pour
la compagnie du Nord-Ouest, au Sault-Sainte-Marie, où la
guerre avec les États-Unis venait de causer beaucoup de dommages.
Il revient ensuite pour
quelques années à ses activités de marchand
voyageur. Après l’absorption de la compagnie du Nord-Ouest
par la compagnie de la baie d’Hudson en 1820, la vie de voyageur
devient moins rémunératrice et Perrault quittera de
nouveau le métier de marchand voyageur. C’est au Sault-Sainte-Marie
qu’il se fixe avec sa famille pour, écrit-il, « … [que]
je puisse travailler de toutes mes forces, ce qui me restera de
jours, pour arriver au rivage de la bienheureuse éternité.
». La vie de voyageur comportait certes son lot de vicissitudes
: querelles, rixes, rivalité entre la compagnie du Nord-Ouest
et la compagnie de la baie d’Hudson, emprise du rhum sur les
« sauvages » et parfois sur les blancs, voire disettes.
Mais Jean-Baptiste Perrault n’en perdait pas pour autant sa
belle équanimité et c’est sur cette note sereine
que prend fin la relation du singulier destin de ce marchand voyageur.
Il s’éteindra en 1844 à l’âge de
84 ans.
De ces milliers de voyageurs qui ont pratiqué la traite
des fourrures pendant quelque deux cents ans, le plus grand nombre
étaient sans instruction, de sorte que ce qu’on sait
d’eux provient surtout des témoignages de leurs employeurs
anglais et écossais. Jean-Baptiste Perrault, ayant bénéficié
de cette formation collégiale encore peu accessible à
l’époque, constitue l’une des rares exceptions
à la règle. L’éducation reçue
au séminaire de Québec allait ainsi lui permettre
de nous léguer un précieux témoignage sur la
vie des voyageurs.
Richard L'Heureux, C. 62
_____________________
1 Cormier, Louis P., Jean-Baptiste
Perrault, marchand voyageur parti de Montréal le 28e de mai
1783. Boréal Express, 1978, 170 p. [ NDLR : Louis P.
Cormier est le préfacier de cette autobiographie.]
Remonter
Le site Internet s’éclate !
En août 2004, notre site Internet a reçu 1030 visiteurs
pour totaliser 1802 visites, des personnes y ayant accédé
à plus d’une reprise. Durant les trois premiers jours
d’août, 303 visiteurs et 538, après huit jours!
Ce record de fréquentation a suivi l’envoi, par notre
webmestre Gilles Payette, C. 55, d’un message personnalisé
aux quelque 500 anciens qui nous ont donné leur adresse de
courriel. L’opération a permis de déceler et
de corriger quelques erreurs dans notre répertoire. Une lettre
a été expédiée aux 37 personnes dont
l’adresse de courriel faisait problème. Nous vous invitons
à vous ajouter au répertoire si vous n’y figurez
pas déjà.
Les contenus nouveaux du site et des conseils de navigation avaient
déjà été présentés lors
de l’assemblée générale de mai 2004.
Le communiqué électronique du 31 juillet 2004 annonçait
la mise en ligne de nombreux enrichissements, entre autres des photos
de classe : 487 photos et 487 listes de noms. Des milliers de «jeunes
anciens» durant les vingt années de collège
de 1945 à 1966 ! Des photos des années antérieures
à 1946 suivront éventuellement. À partir du
site, plusieurs ont imprimé des photos pour leurs enfants
et leurs petits enfants !

Gilles
Payette, le principal artisan de la refonte du site Internet.
Merci aux nombreuses personnes
qui nous ont transmis commentaires et félicitations. Merci
surtout à chacun des membres du comité Internet et
plus particulièrement aux principaux artisans d’un
travail considérable et de qualité. Gilles Payette,
C. 55, webmestre dont la contribution totalise plusieurs centaines
d’heures. Raymond Vézina, C. 55, rédacteur,
réviseur et suppléant au président du comité.
Richard L’Heureux, C. 62, pour la numérisation des
photos de classe et des listes de noms. Bernard Downs, C. 59, pour
les recherches sur nos éducateurs. Réal Rodrigue,
C. 64, pour l’assistance technique au webmestre et le classement
des renseignements. Michel Bourgault, C. 62, dernier venu au
comité, pour des contributions déjà multiples
et variées, comme pour le répertoire des adresses
de courriel.
Les friands de statistiques sur nos visiteurs ont accès
à plein de secrets à l’adresse : https://saintemarie.ca/webstat/https://saintemarie.ca/webstat/
. En août 2004, 15 000 pages consultées et plus 100
000 clics ; des détails par jour, par heure et par pays d’origine
(des visiteurs de 24 pays), etc.
Si vous n’avez jamais pénétré dans l’univers
virtuel de votre association, osez demander de l’aide à
un parent, à un ami ou à un ado. Émotions,
découvertes, surprises et souvenirs sont garantis !
Jacques D. Girard, C. 59, président du comité Internet
Remonter
Le carnet
N. D. L. R. : Nous poursuivons dans ce numéro la publication
de nouvelles « d'intérêt public », dont
la plupart ont été fournies par les membres sur les
formulaires de cotisation 2004. D'abord, il faut rectifier deux
erreurs survenues dans Le Carnet du numéro précédent
: premièrement, le nom de Jacques Gareau,
C. 48, était mal orthographié (Garceau) ; deuxièmement,
les textes distincts reçus des frères Fortier, deux
anciens qui habitent aux USA, ont été présentés
comme une seule et même nouvelle. Ces deux textes, dans leur
version correcte, sont les deux premiers qui suivent.
Wilfrid Fortier, C. 36, qui vit à Biddeford,
Maine, a vécu une belle aventure. En décembre dernier,
cet ancien de 88 ans s'affaisse sur un trottoir, victime d'une panne
de son régulateur cardiaque. Un voisin appelle le 911, les
pompiers arrivent en trombe et ils transportent rapidement notre
homme au centre médical le plus proche. « Je suis chanceux
d'être encore en vie, dit-il ; c'est grâce à
la rapide intervention des pompiers de la caserne centrale. »
Il leur a montré sa reconnaissance en faisant un don de 1000
$ US. [Traduit et résumé du journal local]
André Fortier,
C. 41, son frère qui habite la même ville,
écrit pour sa part : « J'ai pratiqué la médecine
pendant 46 ans. J'ai beaucoup aimé ma profession et j'ai
soigné les pauvres comme les riches. J'ai eu une vie très
heureuse avec de bons enfants et une excellente épouse. J'ai
gardé ma foi, les enfants sont toujours pratiquants mais,
malheureusement, notre paroisse jadis totalement française
est devenue anglaise et bilingue. Je garde un excellent souvenir
du collège Sainte Marie. »
André Pâquet, C. 48, a fait parvenir
la lettre suivante à Guy-E. Dulude, à la suite d'une
réunion de leur conventum. « Quelques mots de haute
appréciation pour la mise en œuvre et la réalisation
de cette rencontre toute fraternelle du 22 septembre dernier. En
ce terrain même où d'épiques combats furent
livrés, nous nous sommes ainsi retrouvés, preux chevaliers,
encore tout rayonnants de nos victoires cumulées et plus
encore reconnaissants pour ces échecs en catastrophe évités.
Moment non moins pénétrant que ce rappel de tous les
bons copains portés disparus, mais dont les prouesses et
autres faits d'armes demeurent pour notre vie gravés.
Et ce bulletin spécial de l'Association des Anciens ! Quelle
bonne idée que ce retour à tous ces professeurs et
éducateurs , religieux et laïcs qui, eux aussi alignés
en combat rangé, faisaient souvent figure d'implacables ennemis
pour nous inciter à la vaillance, au dépassement de
soi et à ce sentiment de victoire plus haut décrit.
Un visage familier s'est presque chaque fois dégagé
à la mention successive des jésuites désignés,
les laïcs en notre temps demeurant en nombre plus discret.
Un bulletin aux vertus magiques, et pourquoi pas miraculeuses, conviendrait
le père Jos Bélanger ; un bulletin qui m'a permis
de reprendre en quelques heures les huit années du cours
classique, cette fois avec la mention magna cum laude,
mais plus encore de revivre les plus belles années de la
vie, celles de l'insouciance, celles où l'on a l'impudence
de se déclarer Vir inter homines, celles de la jeunesse.
Avec mes remerciements pour les membres de la garde. »

Gilles Lavigueur et son épouse, Lise, qui est aussi sa fidèle
collaboratrice.
Gilles Lavigueur, C. 50, continue à se
dévouer corps et âme pour l'Association. À plus
de 70 ans et en dépit de deux séjours à l'hôpital
au cours de la dernière année, il siège encore
avec enthousiasme au Conseil d'administration, s'implique à
plein dans la tenue à jour des dossiers sur les membres et
sur les cotisations, en plus de consacrer beaucoup de temps à
l'organisation de réunions de conventums. Merci et chapeau,
Gilles, pour ta précieuse implication.
Richard d'Auteuil, C. 57, poursuit sa saga dans
la haute Gaspésie. Il écrit : « Merci d'avoir
publié mon petit article sur ma vie en Gaspésie. Montréal
et les amis me manquent, mais j'ai tellement à faire que
je n'ai presque pas le temps d'y penser. Au fait, j'ai été
élu au conseil de la municipalité village de Saint-Léandre
et on m'a nommé pro-maire dès la première réunion.
» @
Jacques-R. Roy, C. 57, écrit sobrement
: « Merci et félicitations ! »
Pierre Marois, C. 58, a présidé
le Conseil des Services essentiels de 1997 à 2001. En mai
de cette même année, il a été élu
président-directeur général de la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse, sa nomination
faisant l'objet d'un vote unanime des membres de l'Assemblée
nationale du Québec. Pierre nous invite à consulter
en particulier le bilan produit à l'occasion des 25 ans d'existence
de la Commission, bilan qu'on peut trouver à l'adresse suivante
: http://www.cdpdj.qc.ca/fr/accueil.asp?noeud1=0&noeud2=0&cle=0
.
Claude Parent, C. 58, s'est retiré en 1995
du monde de l'éducation et du sport, et il a ouvert son propre
bureau de consultation en planification stratégique, communications
et développement des ressources humaines. Comme plusieurs
autres anciens retraités, il demeure fort actif. Notamment,
il occupe la vice-présidence du Panthéon des sports
du Québec, anime des sessions sur le système politique
québécois auprès de diverses clientèles
d'immigrés et il organise des tournois de golf pour des organismes
sans but lucratif qui s'occupent de jeunes victimes de violence
sexuelle ou d'autres jeunes ayant besoin d'une encadrement particulier.
Richard Bergeron, C. 59, dit un gros merci à
ceux et celles qui, par leur dévouement, permettent à
l'Association des Anciens de survivre.
Louis Fournier, C. 62 : « Félicitations
à toute l'équipe de l'Association et du Bulletin !
»
Jacques Tremblay,
C. 62 [commentaire sur un don] : « Rien
à voir avec d'éventuels arrérages… mais
témoignage de reconnaissance pour la persistance et la qualité
d'engagement des soldats qui gardent le fort. »
J. Robert Leroux, C. 63, s'est vu attribuer par
l'Institut de cardiologie de Montréal, où il exerce
la fonction de médecin psychiatre, le prix Reconnaissance
2003 du Conseil local des médecins, dentistes et pharmaciens.
Ce fait dénote l'importance maintenant reconnue aux facteurs
de stress dans la thérapie des affections cardiaques.
Jean Taillefer, C. 63, a reçu en juin 2003
la médaille d'or de la Société canadienne des
anesthésiologistes. Il s'agit de la plus haute distinction
de cet organisme, attribuée en reconnaissance du dévouement
exceptionnel et du travail accompli à promouvoir l'anesthésiologie
québécoise et canadienne.
Denis Forget, C. 64, nous explique ce qu'il fait
depuis 1997, l'année des mises à la retraite selon
lui. « Je joue au hockey, 90 parties par année, avec
le groupe que j'ai fondé, Les Boys de Saint-Eustache,
dont les membres ont de 55 à 75 ans. Je joue aussi à
la bourse, bulle ou pas… Je fais du bénévolat
en pastorale à l'hôpital, suis membre du conseil d'administration
de Centre Aide/Le Grenier populaire et pratique l'art d'être
grand-père. »
François Bernard, C. 66, a occupé
divers postes au sein de la fonction publique fédérale,
toujours comme avocat ou administrateur. Pendant trois ans, il a
été dégagé de ses tâches pour
occuper la fonction de Procureur général de la République
de Vanuatu, dans le Pacifique sud.
Alain-Francois Desfossés, C. 66, est de
retour à Montréal depuis un an. « J'ai pris
ma retraite il y a 6 ans déjà, après quelque
30 années de loyaux services dans l'anonymat de la fonction
publique fédérale. Depuis ma retraite, à l'exception
d'un certain nombre de contrats comme travailleur autonome, je me
consacre à mon développement personnel et, à
titre de bénévole, je siège au conseil d'administration
du Réseau Hommes-Québec, fondé il y a 12 ans
par le psychanalyste Guy Corneau. J'en suis actuellement à
mettre la main finale au plan de croissance du RHQ qui en ferait,
subventions gouvernementales temporaires aidant, un centre d'excellence,
un partenaire majeur du gouvernement du Québec visant le
développement personnel et la santé préventive
pour les hommes du Québec. » @
Serge Denis, C. 67, a été élu
président de la Société québécoise
de science politique pour l'année 2004-2005. Il annonce la
parution de son nouveau livre : Social-démocratie et
mouvements ouvriers, la fin de l'histoire ? Montréal,
Boréal, 2003.
André Fortin, C. 67, mentionne aussi sa
dernière publication, parue en 2003 chez Bellarmin :
D'un désert à l'autre. L'expérience chrétienne.
Robert Laforest, C. 67, a pris sa retraite en
2003, après avoir occupé le poste de directeur général
de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.
Michel Parent, C. 67, est le président,
pour l'année 2003-2004, du club Richelieu d'Aylmer, en Outaouais.
Francine Allard, C. 68, membre de l'Association
des Anciens pour la première année, révèle
qu'elle a publié plus de 30 romans, autant pour les jeunes
que pour le lectorat adulte, chez d'éminents éditeurs
: Pierre Tisseyre, Québec Amérique et Triptyque. En
2000, elle a été présidente d'honneur du Salon
du livre de l'Outaouais. Elle a aussi créé le Prix
Cécile-Gagnon, pour la relève en littérature
de jeunesse. Elle cite le nom d'un quinzaine de collègues
de son conventum qu'elle souhaiterait retrouver au sein de l'Association,
noms qui ont été transmis au responsable de la vie
des conventums : Suzanne Asselin (secrétaire du maire de
Montréal), Claire Baron, Claude Caron, Johanne Dorais, Lucie
Gauvreau, Maurice Harrison (Les Boules, QC), Normand Laforest, Andrée
Pelletier (comédienne), Michel Simpson, Pierre Simpson (Verdun),
Johanne Tellier, (fille de feu le comédien feu Jean-Pierre
Masson), Johanne Verdon (CKAC).
Jacques Fournier, C. 68, a été bâtonnier
de la province de Québec en 1998-1999 et il a été
nommé juge à la Cour supérieure du Québec
en octobre 2002.
Remonter
Passons sur l’autre rive (Marc 3,35)
N. D. L. R. : Dans le numéro précédent,
Raymond Léger était présenté comme membre
du conventum 42 alors qu'il appartient au conventum 52.
Paul Miquelon, C.20, avocat, décédé
à Québec le 25 avril 2004, à l'âge respectable
de 102 ans et 8 mois. Il avait été nommé juge
à la Cour supérieure du Québec en 1958, par
le Premier ministre d'alors, John Diefenbaker, et il y a siégé
jusqu'à sa retraite en 1976. Il s'est beaucoup intéressé
à la politique, comme son frère Jacques, qui a été
ministre et chef de cabinet sous le gouvernement Duplessis. Celui-ci
a déclaré au sujet de Paul : « Durant toute
sa vie, il a voué un amour inconditionnel au droit. Il ne
supportait pas l'injustice. »
Stéphane Valiquette, s. j. , C. 31, décédé
à Saint-Jérôme le 23 juin 2004. Sa vie a été
marquée par deux engagements principaux. Le premier dans
l'éducation, au collège de Saint-Boniface au Manitoba
et au collège du Sacré-Cœur à Sudbury
en Ontario. Le deuxième dans l'œcuménisme, particulièrement
au Centre canadien d'œcuménisme dont il fut le directeur
adjoint de 1967 à 1987. Toute sa vie, il s'est impliqué
activement dans le dialogue interreligieux, particulièrement
entre les juifs et les chrétiens.
Bernard Hébert, C. 32, psychologue, décédé
à Montréal le 29 mai 2003. Il a été
associé pendant de nombreuses années à l'Institut
de réadaptation de Montréal et à l'hôpital
Marie-Enfant où il s'est beaucoup impliqué auprès
des jeunes handicapés.
Bernard Thibault, C. 33, ingénieur et homme
de lettres, décédé à Saint-Constant
le 29 avril 2004.
Gérard Dugas, C. 35, optométriste,
décédé à Maria en Gaspésie le
5 juillet 2004.
Robert Baillargeon, C. 37, administrateur, décédé
à Montréal le 14 mai 2004.
Gabriel Phaneuf, C. 39, médecin, décédé
à Mont Saint-Hilaire le 22 mars 2004.
Jean Phaneuf, C. 39, médecin anesthésiste,
décédé à Saint-Hyacinthe le 2 juillet
2004.
Louis-Philippe Brizard, C. 43, décédé
à Montréal le 12 avril 2004.
Bernard Signori, C. 45, prêtre, décédé
à l'hôpital de Joliette le 3 avril 2004. Il résidait
à Verdun, ayant terminé son ministère à
la cure de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, entre 1982
et 2002. L'abbé Signori a enseigné la théologie
au Grand séminaire de Montréal de 1954 à 1966,
puis il a été curé de la paroisse Saint-Zotique
de 1966 à 1982. À compter de 1957, il s'est aussi
dévoué auprès du mouvement scout, d'abord comme
aumônier de la meute de louveteaux Saint-Victor, puis comme
aumônier du groupe scout guide Saint-Pie-X. Il siégeait
à titre de juge au Tribunal ecclésiastique de l'Archevêché
de Montréal. De plus, il a été aviseur moral
de l'Association des parents catholiques du Québec et directeur
fondateur de l'Œuvre de Jésus Miséricordieux.
Robert Bilodeau, C. 47, comptable, décédé
à Montréal le 7 juin 2004.
Jean Désormeaux, C. 48, optométriste,
décédé à Montréal le 12 juillet
2004.
André Fauteux, C. 48, décédé
à Laval le 10 mars 2004. Il était juge retraité
de la cour du Québec, chambre de la jeunesse.
Jean-Guy Nadeau, C. 48, pharmacien, décédé
à Laval le 29 juillet 2004.
Yves Lachapelle, C. 50, ingénieur, décédé
à Laval le 3 avril 2004.
Guillaume Daveluy, C. 51, fonctionnaire à
la CSST, décédé à Montréal le
26 mai 2004.
Claude Langlois, C. 51, médecin interniste,
décédé à Montréal le 9 mai 2004.
Jean-Guy Alary, C. 52, agronome et professeur
retraité de l'université du Québec à
Montréal, décédé à Montréal
le 27 juillet 2004.
Gilbert Godin, C. 52, avocat, décédé
à Montréal le 25 août 2004.
Maximin Gagnon, C. 54, prêtre, décédé
à Montréal le 12 mai 2002,
Robert Morin, C. 55, de la congrégation
de Sainte-Croix, décédé à Montréal
le 11 juin 2004. Il a fait son noviciat à Bennington au Vermont,
son scolasticat et son baccalauréat en théologie au
scolasticat Notre-Dame de Sainte-Croix au Mans, en France, puis
il a complété une maîtrise en théologie
à l'Université d'Angers. Après avoir enseigné
pendant deux ans au collège italien Mezzaro di Primero, il
obtient son doctorat en Sciences religieuses de l'Université
de Strasbourg. Il remplit ensuite diverses fonctions au sein de
sa communauté, notamment à l'oratoire Saint-Joseph
et dans des œuvres de bienveillance. De 1992 à 2001,
il occupe à Rome le poste d'assistant général.
En 2001, il est nommé directeur général du
collège Notre-Dame à Montréal.
Jean-Jacques Gauthier, C. 58, médecin,
décédé à Montréal le 10 août
2004. Il a été chef du service de pneumologie et chef
du département de médecine à l'hôpital
du Sacré-Cœur, ou il a aussi fondé le centre
de réadaptation respiratoire.
Raymond Guindon, C. 60, ancien professeur à
la Commission scolaire de Montréal, décédé
le 22 mars 2004. Il résidait à Blainville.
Jean-Paul Fortin, C. 61, enseignant, décédé
à Montréal le 23 juin 2004.
Remonter
|