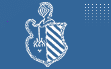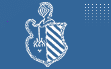Le mot du president
Carnet
Laisser des traces (R. L’Heureux)
Passons sur l'autre rive
Le mot du Président
Shakespeare, Mercure et autres considérations
Une fête annuelle réussie, un site Internet fréquenté
et des Anciens enthousiastes ! L’Association des Anciens du
Sainte-Marie vogue allègrement vers son 200e anniversaire.
Mais vous aimeriez participer encore plus «intimement»
à cette merveilleuse aventure. Qu’à cela ne
tienne ! Présentez-vous à la prochaine assemblée
générale à 11 heures le 12 octobre prochain
au Gesù (ne pas confondre avec la Fête annuelle du
mois de mai) et faites profiter l’Association de vos idées
et, pourquoi pas, de votre candidature au conseil d’administration.
Le buffet servi après la réunion vous permettra de
retourner au bureau — ou au golf ! — à l’heure
prévue, avec un enthousiasme renouvelé. Au fait, avez-vous
payé votre cotisation 2001 et visité notre site Internet ?
Votre cotisation, c’est le « To be or not to be »
de l’Association et le site Internet, son Mercure !
Émile Robichaud
Remonter
Le carnet
C. 27 Roger Larose, l’un des plus anciens
de nos anciens, nous écrit d’Outremont cette confidence :
«J’ai 90 ans et je passe encore souvent devant le mur
de pierre de la rue de Bleury. C’est encore mon alma mater.»
C. 36 Wilfrid J. Fortier habite Biddeford,
dans le Maine. Il a organisé une campagne de financement
pour rénover le local de sciences de l’école
privée St-James. Avec les 30 000 $ recueillis, on a pu refaire
le plancher, installer de nouveaux lavabos et renouveler l’équipement.
Des parents ont même offert un tout nouveau squelette.
C. 41 Guy Girardin, de Saint-Marc-sur-Richelieu,
nous confie qu’il est maintenant un rentier… paresseux.
C. 42 Maurice da Silva, d’Outremont,
a rédigé un article intitulé «La Communauté
de Route Charles-de-Foucault de Montréal, 1945-1960»
pour un numéro spécial de la revue Échanges,
nos 33-34, septembre 2000 et janvier 2001. Cette revue se consacre
à la descendance spirituelle de Charles de Foucault au Québec
aujourd’hui.
C. 42 Gaston Rondeau, de Marieville, préside
depuis 1993 l’Association des juges retraités du Québec.
De plus, il a été nommé président d’honneur
des fêtes du 200e anniversaire de Marieville qui se tiennent
en 2001.
C. 48 Louis Balthazar, de l’Université
Laval, a reçu, à l’automne 2000, une bourse
Fullbright pour l’enseignement et la recherche, du Bridgewater
State College au Massachusetts.
C. 50 Léo Côté, de Ville
Lasalle, est secrétaire de l’Association des aînées
et aînés francophones du Canada.
C. 51 Pierre Tanguay, d’Aylmer, a été
au service du gouvernement canadien pendant une trentaine d’années.
Il a été notamment vice-président à
l’Agence canadienne de développement international
(ACDI), ambassadeur au Guatemala et au Honduras, ambassadeur auprès
de la Francophonie à Paris. «J’ai, écrit-il,
célébré le nouveau millénaire en prenant
ma retraite, pour jouer au golf et me lancer dans l’art culinaire…»
C. 53 Gilles Bernier, de Saint-Georges de
Beauce, est revenu au Canada en août dernier après
avoir terminé un mandat de quatre ans comme ambassadeur du
Canada en Haïti.
C. 53 Bernard Courteau est depuis deux ans
professeur retraité de l’Université de Sherbrooke.
Il a été président de l’Association mathématique
du Québec de 1993 à 2000. En décembre de l’an
dernier, il a reçu le prix Adrien-Pouliot de la Société
mathématique du Canada. Ce prix est décerné
annuellement depuis 1995 pour une contribution importante et soutenue
à l’enseignement des mathématiques.
C. 55 André Brunet, résidant
à l’Île-des-Sœurs, exerce sa spécialité
de gérontopsychiatre à l’hôpital Jean-Talon
de Montréal ainsi qu’à l’Hôtel-Dieu
de Saint-Hyacinthe. Il écrit : «Je songe à
la retraite, mais quand on aime ce que l’on fait et que de
plus on rend service aux gens âgés en atténuant
leurs souffrances morales… c’est une décision
qu’il est très difficile de prendre.»
C. 55 Yvon Lussier a célébré
le 27 mai dernier son 40e anniversaire de vie sacerdotale. Il est
toujours actif comme pasteur curé à la paroisse Saint-Albert-le-Grand
de Rosemont.
C. 56 Arthur Amyot est membre du comité
exécutif ainsi que du Conseil de l’Université
de Montréal. À l’hôpital du Sacré-Cœur,
il est à la fois responsable de l’enseignement et des
activités académiques du département de psychiatrie
et directeur adjoint de la recherche au même département.
Il réside à Outremont.
C. 57 Guy Pinard, habitant Brossard, déclare
être maintenant à la retraite après 40 ans de
service au journal La Presse. Heureusement, on peut encore lire
occasionnellement les articles qu’il rédige à
titre de pigiste
C. 59 Jacques D. Girard est travailleur autonome
à Montréal. Il vient d’adapter pour le Canada
Merveilles et secrets de la langue française, un livre de
500 pages publié en 2001 par Sélection du Reader’s
Digest. Entre autres merveilles, cet ouvrage donne l’étymologie
et trace les changements de sens d’environ 6000 noms communs,
ainsi que de quelque 1700 noms de famille choisis parmi les plus
fréquents au Québec.
C. 59 Claude Vaillancourt nous a expédié
la missive suivante par courriel. « Il fait bon de découvrir
le site Internet de mon Alma Mater après quelques années
d'exil dans la Vieille Capitale. Je me souviens avoir quitté
Montréal en 1959 pour suivre ma famille vers une nouvelle
ville, pour m'y faire de nouveaux amis... Une nouvelle vie quoi
! Lorsque je me retrouve à Montréal, je retourne faire
les cent pas sur la rue de Bleury. Je me surprends même à
l'accasion à jeter un coup d'oeil dans notre vénérable
chapelle du Gesù, la seule à avoir résisté
au pic des démolisseurs. Vive le progrès? Je prends
donc avec plaisir quelques moments arrachés à une
confortable retraite pour saluer tous mes chers confrères
qui comme moi ont hanté les sombres corridors du Collège,
parfois même les interminables souterrains qui reliaient le
Collège au Gesù. Je lève mon verre à
votre santé et vous salue respectueusement ! Au plaisir de
vous revoir un jour ! POUR CEUX QUI POURRAIENT AVOIR DU TEMPS:
bacchus999@hotmail.com .»
C. 60 Bernard Bélair est devenu, au
printemps de 2001, supérieur du Gesù et directeur
général des Salles du Gesù. Il siège
également à titre d’aumônier au conseil
d’administration de l’Association des anciens élèves
du collège Sainte-Marie.
C. 62 Gérald Bernier et Louis Fournier
préparent déjà la prochaine réunion
de leur conventum qui aura lieu en 2002. Voir leur communiqué
publié sous la rubrique «Vie des conventums».
C. 62 Michel Bourgault nous a écrit
ce qui suit via Internet. «C'est avec un grand plaisir que
j'ai visité le site des Anciens du Collège. Félicitations
à toute votre équipe! Je sais combien de temps il
faut consacrer à pareil projet, aussi je vous admire d'avoir
réussi à le mettre sur pied. Je crois que nous avons
là un moyen adapté à la vie d'aujourd'hui de
garder vivante la tradition du Sainte-Marie.
Comme nouvelle pour le Bulletin, j'aimerais signaler que j'ai participé
au Colloque de la Société des Études Anciennes
du Québec, tenu à l'UQAM au mois d'avril. La réunion
regroupait une trentaine de professeurs de tous les niveaux intéressés
à l'enseignement de l'histoire et des langues anciennes.
On y a fait le point sur l'enseignement du latin et le pronostic
était assez désolant. Au Québec, le latin est
en perte de popularité ou en voie de disparition dans plusieurs
institutions. Pour ma part, j'ai fait un compte-rendu d'un cours
de latin que je donne en activité parascolaire depuis 3 ans
à l'école secondaire Thérèse-Martin
(Joliette). Bon an mal an, j'initie environ 5 élèves
au latin. J'ai essayé sans succès d'intéresser
de jeunes enseignantes ou enseignants de français surtout.
À deux ans de ma retraite officielle, le site Internet du
Village Emmaüs et ce projet de cours de latin me permettent
d'entrevoir une deuxième vie...»
C. 62 Roch Denis a été nommé
en juin dernier recteur de l’Université du Québec
à Montréal. Il possède une longue expérience
du milieu universitaire, à titre, entre autres, de professeur
de science politique à l’UQAM, de président
de la Société québécoise de science
politique et de président de la Fédération
québécoise des professeurs d’université.
Il a publié récemment le livre Les défis de
l’université au Québec.
C. 64 Luc Pilon, de Saint-Lambert, le dynamique
chef adjoint du Service d’orthopédie de l’hôpital
Saint-Luc, a présidé le 27 mai dernier la marche orthopédique
Hip Hip Hourra sur le belvédère de la place Ville-Marie.
Il souhaite ardemment qu’en 2002, les anciens, anciennes et
leurs familles qui ont bénéficié de chirurgie
orthopédique se joignent à cette marche bénéfice,
symbole de la reprise de mobilité après une opération.
Nous vous tiendrons informés de l’événement,
notamment au moyen du site Internet.
C. 64 Réal Rodrigue, comme notre ami
Jacques D. Girard, s’intéresse à la généalogie.
Il est vice-président et webmestre de l’Association
des familles Rodrigue et éditeur du bulletin de liaison de
cette association. Bibliothécaire aux services informatisés
du Service des bibliothèques de l’UQAM, il est à
ce titre webmestre des bibliothèques de l’UQAM. Il
habite le Nord de Montréal.
C. 65 Réal Lalande demeure à
Ottawa et il travaille pour l’Unité d’appui au
programme de coopération canadien (UAPC) situé à
Port-au-Prince en Haïti.
C. 66 André Lacroix, de Saint-Lambert
est directeur du programme d’endocrinologie à l’Université
de Montréal. Il est membre du conseil d’administration
de la Société d’implantation du centre hospitalier
universitaire de Montréal (CHUM).
C. 67 Gilles Lépine vit à Saint-Hyacinthe.
Il occupe le poste de directeur général du cégep
Marie-Victorin et il préside l’Association provinciale
des directeurs généraux de cégeps. Il est aussi
vice-président de l’hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine
et membre du comité exécutif du Conseil régional
de développement de l’Île de Montréal.
De plus, il préside le Gala d’honneur au mérite
de la Chambre de commerce et de l’industrie de l’Est
de l’Île de Montréal.
C. 68 Jean-Pierre Plante, humoriste d’Outremont,
nous annonce qu’il est maintenant questeur urbain et édile
curule. C’est peut-être pourquoi il dit avoir aussi
gagné le prix Nobel de curling…
Remonter
Laisser des traces…
« Une image vaut mille mots… » Oui
mais, quelquefois, c’est l’inverse… Une image
décrit certes fort bien l’apparence, les formes, les
couleurs d’une personne, d’un objet ou d’un paysage.
Mais au-delà de la réalité visuelle, n’y
a-t-il pas d’autres aspects de la vie, d’une situation,
qui peuvent difficilement se transmettre autrement qu’avec
des mots.
Cette réflexion m’est venue à la lecture d’un
passage des Relations des Jésuites, ces rapports qu’écrivaient
ces missionnaires vivant au Canada pour rendre compte à leurs
supérieurs de leurs activités et de leurs observations.
Je suis tombé sur le récit du voyage du père
Charles Albanel à la baie James. Parti de Québec en
canot en 1671 avec un groupe d’Indiens et de Français,
il remonte le Saguenay depuis Tadoussac jusqu’au lac Saint-Jean.
De là, le voyage se poursuit jusqu’au lac Mistassini
d’où le missionnaire et ses compagnons descendent la
rivière Nemiscau (Rupert) jusqu’à la baie James,
périple qui s’étend sur plusieurs mois.
Arrivé à l’eau salée, Albanel rencontre
les Kilistinons maintenant appelés Cris. Précédés
de leur chef, ils viennent au-devant du missionnaire. « Le
Capitaine me prend d’une main et de l’autre se saisit
de mon aviron…», raconte Albanel. « Mon aviron »,
dit-il. Si Albanel avait son propre aviron, c’est qu’il
devait s’en servir. On se représente volontiers le
Jésuite d’autrefois, assis au fond du canot, pensif
ou observant les lieux, voire lisant son bréviaire pendant
que les autres pagayent. Mais qu’il pagaie lui-même
comme les autres, ça c’est moins évident…
Ces hommes ne faisaient donc pas qu’enseigner ou prêcher,
ils devaient mettre l’épaule à la roue, pagayer
même, eux aussi. Par-delà les trois siècles
qui séparent la lecture de ce passage de sa rédaction,
ce récit m’a peut-être aussi frappé du
fait que j’ai visité cette partie de la baie James.
J’ai alors pu comprendre que la vie des habitants de cette
région, il y a à peine cinquante ans, n’était
pas tellement différente de celle décrite par le père
Albanel au XVIIe siècle. Une vie qui tourne autour de la
chasse, de la pêche et de la traite des fourrures.
Je me dis aussi que les Relations des Jésuites sont un des
principaux documents qui décrit, au jour le jour, la vie
telle qu’elle se passait au Canada à l’époque
où les Français s’y implantaient. Les Jésuites
d’alors écrivaient pour leurs supérieurs et
pour leurs confrères, sans probablement se douter que leurs
récits intéresseraient encore des lecteurs quatre
siècles plus tard. D’où l’importance de
laisser des traces, sinon pour les générations futures,
du moins pour ceux qui viendront immédiatement après
nous. On laisse volontiers des photographies, des films vidéo,
mais des écrits, c’est moins fréquent de nos
jours. Pourtant, ils peuvent être tellement plus évocateurs.
Vous étiez vivant à l’époque de la deuxième
guerre mondiale ? Comment voyait-on l’avenir dans ces années-là
? Nous avons tous vécu les longues années de guerre
froide. Qui aurait pensé, il y a 25 ans, que la guerre froide
allait graduellement s’éteindre au cours des dix dernières
années ? Quels étaient les points forts de la vie
de collégien au moment où vous fréquentiez
le collège ? Autant de sujets d’observation, de réflexion,
à évoquer au moyen de l’écriture.
Certains anciens, dont récemment Jean-Louis Roux par exemple,
ont publié l’histoire de leur vie. Marguerite Lescop
a connu un grand succès de librairie avec le simple récit
de sa vie de mère de famille. Sans aspirer à des succès
comparables, chacun de nous pourrait consigner certains moments,
tristes ou gais de la vie, décrire la façon dont nous
voyions le monde à certains moments précis de notre
existence. Si ça ne devait servir qu’à nos enfants,
à nos petits-enfants, ce serait déjà fort utile.
Peut-être même serions-nous les premiers à en
tirer profit…
Richard L’Heureux, C. 62
Remonter
Passons sur l’autre rive (Marc
3,35)
Florian Larivière, s.j., ancien recteur
du collège, décédé le 11 mai 2001.
Florian Larivière naît en 1918 à Joliette et
il fait naturellement ses études classiques au séminaire
local, dirigé par les Clercs de Saint-Viateur. À la
fin de son cours, à la surprise de tous, il décide
d’entrer chez les Jésuites et devient prêtre
en 1950. Après une dizaine d’années d’enseignement,
il fait surtout carrière dans l’administration :
recteur du collège Garnier à Québec, puis du
collège Saint-Ignace, il fut le dernier recteur jésuite
du collège Sainte-Marie. Il fut aussi pendant trois ans président
de la Fédération des collèges classiques. On
pourra lire dans la revue Jésuites canadiens un article fort
intéressant rédigé par Rémi Potvin,
s.j.
Gilles Lefebvre, C. 41, décédé
le 27 mai 2001.
On l’a surtout connu comme le père des Jeunesses musicales
du Canada, mais il était avant tout musicien. Animateur de
premier ordre, il crée en 1950 le camp des Jeunesses musicales,
devenu aujourd’hui le Centre d’art Orford. C’est
lui qui, à titre de directeur artistique associé,
planifie le Festival mondial de l’Exposition universelle de
Montréal en 1967. Par la suite, il a été tour
à tour directeur du Centre culturel canadien à
Paris, directeur associé au Conseil des arts du Canada et
enfin, de 1991 à 1999, président du Conseil des arts
de la Communauté urbaine de Montréal. On relira avec
intérêt l’article que François Tousignant
lui a consacré dans Le Devoir du 29 mai 2001, accessible
à l’adresse Internet suivante : http://www.ledevoir.com/public/client-css/news-webview.jsp?newsid=1733
AUTRES DÉCÈS
Marcel Aubuchon, C. 50, professeur, décédé
le 10 juillet 2001.
Rolland Blais, c.r., C. 52, avocat, décédé
le 24 juin 2001-07-01.
Wilfrid Boileau, C. 25, médecin bactériologiste,
décédé le 19 juin 2001.
Roland Caron, C. 39, comptable.
André Dalpé, C. 46, chirurgien dentiste.
Roger David, C. 59, avocat.
Jean-Paul de la Sablonnière, C. 46, décédé
le 3 août 2001
René Dufresne, C. 31.
Claude Famélart, C. 58, décédé
le 24 mai 2001. Claude était le frère de Michel, C.
57 et de Louis, C. 59.
Jacques Fiset, C. 48, chirurgien dentiste, décédé
le 12 mai 2001.
Bernard Foisy, C. 46, prêtre.
Louis-Marc Gauthier, C. 46, décédé
le 6 juin 2001.
Pierre-Claude Hamel, C. 43, décédé
le 12 juin 2001. Le docteur Hamel a œuvré pendant près
de 35 ans comme chirurgien général à l’hôpital
de LaSalle.
André Laurin, C. 48, dentiste, décédé
le 30 juin 2001.
Claude Lavallée, C. 50, décédé
le 11 juillet 2001.
Léo R. Leblanc, c.r., C. 26, avocat, décédé
le 6 juin 2001. D’après les personnes de Granby qui
l’ont bien connu, Me Leblanc était «un gentleman,
tennisman, historien et poète».
Roger Lefebvre, C. 43, médecin anesthésiste.
Louis-Philippe McComber, C. 27, décédé
le 14 mars 2001. M. McComber était propriétaire d’une
importante entreprise de fourrures à Montréal. Il
était le père de Michel, C. 55, décédé
depuis quelques années, dont le talent de caricaturiste a
fait les beaux jours du journal Le Sainte-Marie.
Dom Jean Vidal, o.s.b., C. 38, décédé
le 26 mars 2001. Moine à l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac,
Jean Vidal a joué un rôle déterminant lors de
la construction de la nouvelle hôtellerie et de l’église
abbatiale. Ordonné prêtre en décembre 1949,
il exerça la fonction d’hôtelier pendant plus
de 40 ans, avec modestie et dévouement.
Remonter
|