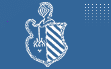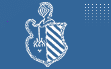2013-02-12
Deux décisions anodines, mais capitales pour mon avenir
Par Guy Pinard, C. 57, journaliste retraité.
Il arrive parfois dans la vie qu’on prenne de ces décisions qui peuvent chambouler une vie tout en paraissant à prime abord bien anodines parce qu’on n’en saisit pas toute la portée.
Un exemple. Nous sommes au début de l’été 1953. Comme j’ai seulement 15 ans, il m’est impensable de chercher un travail sérieux et payant, autre que celui de livrer des paniers d’épicerie pour 25 cents de pourboire à la fin de la course.
Plutôt que de perdre mon temps avant d’entreprendre mon année de Méthode au collège, je décide d’acheter un cours de dactylographie, et de m’appliquer à le suivre religieusement et quotidiennement sur la vieille machine à écrire achetée par mes parents dans le but de m’encourager à accueillir le doigté rapide dont j’ignorais pour le moment l’éventuelle utilité. Encore aujourd’hui, 60 ans plus tard, je me revois, tapant inlassablement des lignes et des lignes de <e>, de <i> ou de <q> (que j’avais de la difficulté à rejoindre d’instinct avec mon auriculaire gauche), en m’assurant que la force de la frappe soit la plus égale possible.
Le doigté devait me servir dès le mois de septembre suivant, alors que je décide, sans le savoir sur le coup, de mon plan de carrière. Deux ou trois fois par semaine, je publie, au babillard de la salle de récréation des petits (avec la bénédiction du père Gérard Delisle), un genre de <journal à potins> qui raconte les exploits de nos vedettes du parascolaire, plus particulièrement nos étoiles du sport. Je le constaterai plus tard, ce sont mes premiers balbutiements en journalisme.
Devant mon intérêt évident pour le sport, le père Jean-Louis Brouillé me demande alors de signer la chronique <Sports> du journal Le Sainte-Marie, ce que j’accepte évidemment.
Plus tard, à mon arrivée sur le campus de l’Université de Montréal, ma réputation en ce domaine m’a précédé, et c’est à titre de chroniqueur sportif que j’entre au journal Le Carabin, chronique que je signe pendant deux ans, de plus en plus convaincu que le journalisme m’occuperait pour le restant de mes jours.
Un coup de chance
Au printemps de 1961, Lionel Lemay, directeur des sports à l’Université de Montréal, me convoque à son bureau. Il me fait part d’un appel de Marcel Desjardins, directeur des sports à LA PRESSE, qui cherche un surnuméraire pour les vacances d’été, et me demande si la chose m’intéresse. J’hésite un bon moment parce que, au cours de la saison de hockey des Carabins qui venait de se terminer, j’ai eu une sérieuse prise de bec (par journaux interposés) avec André Trudelle, chroniqueur de hockey à LA PRESSE, et je crains que mon arrivée à LA PRESSE, fût-ce pour un été, puisse très mal se passer.
C’est donc avec une certaine appréhension que je me présente à LA PRESSE à 19h, le 1er mai 1961. Et qui m’accueille le premier dans le bureau des Sports ? André Trudelle évidemment ! Heureusement, tout s’est bien passé, André est même devenu mon mentor, et 10 jours plus tard, je touchais mon premier chèque de paie de 68$, soit 60$ pour 32,5 heures de travail, plus 8$ pour la prime de nuit, moins évidemment toutes les retenues, fiscales ou autres.
Sauf pour les périodes des trois grèves de 1964, 1971 et 1977 qui m’ont forcé à chercher temporairement du boulot ailleurs, LA PRESSE aura été mon seul employeur quand je prends ma retraite 40 ans plus tard, jour pour jour, le 1er mai 2001, à l’âge de 63 ans. J’ai touché un peu à tout pour éviter de m’ennuyer : les sports évidemment (surtout le football, l’athlétisme, la natation et le ski), l’olympisme, les finances, les transports, une chronique quotidienne à la page 3, la direction des pages du centenaire de LA PRESSE en 1983-84, l’architecture, le patrimoine, la construction résidentielle, le tourisme, tant et si bien qu’au moment de ma retraite, j’assume la direction de cinq cahiers fort hétéroclites : Mode, Santé, Mon toit, Vacances/voyage et Auto.
Deux dossiers m’ont plus particulièrement marqué. Tout d’abord, le monde olympique. Après la couverture des Jeux de Mexico en 1968 et des Jeux de Munich en 1972, Jean Sisto, mon patron de l’époque, me demande de me consacrer entièrement à la préparation des Jeux de Montréal en 1976. Pendant quatre années fortement tourmentées (je n’apprends rien à personne), je voyage aux quatre coins du monde sur les talons du maire Jean Drapeau et au gré des activités du Comité international olympique. Et pour couronner le tout, j’ai le plaisir de diriger l’équipe de 54 journalistes, photographes et auxiliaires qui couvre tous les événements reliés aux Jeux olympiques de Montréal, du 17 juillet au 1er août 1976. Mes connaissances du dossier olympique montréalais incitent le juge Albert H. Malouf à m’engager à titre de recherchiste pendant les deux premières années de la Commission d’enquête sur le coût des Jeux de la XXIe Olympiade.
Deuxième dossier marquant, l’univers des <vieilles pierres>. Pour souligner le 350e anniversaire de fondation de Ville-Marie (Montréal) en 1992, je rédige 350 articles consacrés au patrimoine, à l’histoire et à l’architecture de Montréal et de sa grande région. Il en est sorti six livres formés des textes intégraux rédigés pour chacun de ces monuments. Commencée en août 1985, cette série se termine en janvier 1993. Ce travail me vaut le prix Paul-Henri Lapointe 1989 de l’Ordre des architectes du Québec ainsi que la médaille d’honneur de la Société historique de Montréal en 1992. La même année, le tome I est choisi pour faire partie des 30 volumes de la <petite bibliothèque du parfait Montréalais>, en compagnie d’auteurs comme, entre autres, Michel Tremblay, Réjean Ducharme, Gabrielle Roy, Gratien Gélinas, Yves Beauchemin, Claude Marsan, Mordechaï Richler et le dramaturge Marcel Dubé, gardien de notre équipe de hockey senior l’année du Centenaire du collège, en 1949.
Ma famille
Pendant ce temps, ma tendre moitié Martha Scott, mariée le 29 décembre 1962 (faites le calcul…), s’occupe prioritairement de l’éducation de nos trois enfants, Alain John, Martin-Frédéric et Nathalie, tous trois détenteurs d’un diplôme universitaire, avant d’entreprendre elle-même une carrière de programmeur à Hydro-Québec. Et aujourd’hui, nous sommes les heureux grands-parents de sept petits-enfants, qui viennent souvent égayer notre maison de Shefford, dans les Cantons-de-l’Est.
J’ai aujourd’hui 75 ans. Je garde un souvenir impérissable de mes huit années au collège comme élève et de mes quatre autres comme collaborateur du père Delisle et de mon confrère de conventum Pierre Levac, directeur des Sports au début des années soixante. Mais tout cela n’aurait pas été possible si, en cette journée de chaleur et de farniente de l’été 1953, je n’avais pas pris la décision de maîtriser à tout jamais les mystères du clavier d’une machine à écrire.
|