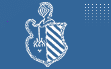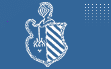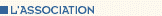






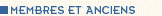




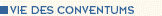


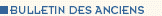

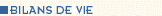

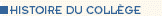


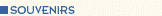







|
BULLETIN DES ANCIENS |
 |
Extraits du Bulletin d'avril
2008
|
| |
Le
mot du président
| |
|
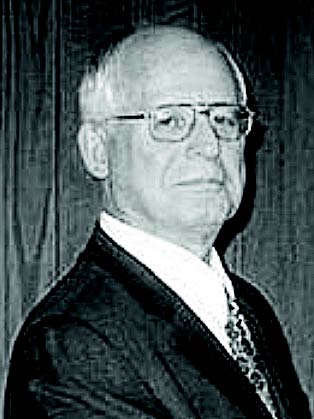 |
Quand on y tient !
Lors de sa présentation du bilan de 2007, notre trésorier, Jacques-Marie
Gaulin, faisait remarquer aux membres du conseil d’administration que
les dons représentaient 40% des revenus de l’Association.
Cela montre jusqu’à quel point les Anciens tiennent à ce que leur
Association vive! Sans cette «contribution volontaire», l’Association
survivrait à peine! En maintenant la cotisation à un niveau raisonnable,
nous la gardons à la portée de tous, mais seul le «surplus» apporté par
les dons rend possibles la publication du bulletin et la tenue de la
Fête annuelle.
|
Les 447 Anciens qui ont payé leur cotisation en 2007, 280, soit 62,5%,
ont ajouté un don à
leur cotisation.
Ces dons sont la planche de salut de l’Association : la suite de l’histoire vous appartient !
Le président, Émile Robichaud
|
Remonter
Fête annuelle des anciens
Fête annuelle des Anciens,
le lundi 5 mai 2008,
au Gesù, 1200, rue de Bleury à Montréal
L’Association maintient le retour de la fête annuelle en mai, qui lui a valu une excellente
participation en 2007. Cette année, la fête annuelle aura lieu le lundi 5 mai !
Profitez de cette occasion de revoir vos confrères et consoeurs voire d’anciens professeurs
dans une ambiance joyeuse et décontractée. Inscrivez donc ce rendez-vous à
votre agenda et invitez d’autres membres de votre conventum à se joindre à vous.
Programme:
• 15 h 30 • Inscription
• 16 h 30 • Messe à l’église
• 17 h 15 • Assemblée générale à la salle d’Auteuil
• 18 h 00 • Réception
|
Remonter
Vie des conventums
L’année 2007 fut une année faste pour les réunions de conventums, avec un total
de six réunions, ce qui témoigne de l’intérêt soutenu des Anciens de se retrouver entre
collègues pour partager leurs souvenirs de collège, mesurer le chemin parcouru.
Les textes et photos qui suivent relatent les réunions des conventums 48, 49, 55, 59 et 62
qui se sont réunis en 2007 et celle du conventum 50 qui s’est réuni en mai 2006. Le site
Internet de l’Association présente d’autres photos (en couleur) des réunions de conventums.
|
Conventum 48
L’automne dernier, par une belle fin de matinée,
plusieurs Anciens se sont donné rendez-vous
pour déjeuner au Manège militaire des
Hussards, avenue de la Côte-des-Neiges.
L’immeuble a des murs entiers tapissés de photographies
de soldats et d’officiers ayant fait la
guerre de 39-45 et celle de 14-18.
Nous étions tous à déambuler dans ce bâtiment
vétuste, aux marches d’escalier usées qui
nous rappelait notre vieux collège Sainte-
Marie que nous fréquentions dans les années
40. Plus de 60 ans!
Pourtant, tout le monde était en forme, bon
pied, bon oeil. Surprenant quand même. Ou alors,
ces rencontres annuelles nous rajeunissent.
À l’heure du lunch, au surplus délicieux,
digne des meilleures tables de Montréal, avec
entre autres, un plat de saumon succulent, tout
le monde se mit à parler. On aurait pensé entendre
des blagues, des anecdotes, mais c’est
de nos professeurs dont les gens parlaient
surtout: Jean-Louis Brouillé, Maurice Vigneau, Émile Cambron, Bernier, Rancourt, Gareau,
Taché, St-Laurent. On pourrait tous les nommer.
Tous ces hommes étaient formidables,
admirables. Et puis, certains d’entre nous se
sont mis à les imiter. C’était tellement drôle.
Mais triste à la fois, puisqu’ils sont tous
disparus. Souvenirs, nostalgie.
Après avoir bien mangé et bien bu, nous
nous sommes promis de nous revoir en octobre
2008, pour le 60ième.
Mais tous n’y seront pas. Robert Pâquet et
Jean-Guy Nadeau, deux confrères que je connaissais
bien et que j’aimais beaucoup nous ont
quittés. Allez, la vie est ainsi faite.
Jean-Jacques Charette, C. 48 |
Conventum 49
Conventum 1950
Le conventum 50 se réunissait en mai 2006 au
restaurant «Les Infidèles» pour la première fois
depuis leur 50ième anniversaire. Un conventum
vigoureux puisqu’il rassemblait 34 anciens!
Chapeau aux organisateurs et en particulier à
Gilles Lavigueur pour cette réussite!
 |
 |
| C. 50 : Yves Lefebvre, Jean-Jacques Croteau et Jacques Beaudoin |
C. 50 : Maurice Lagacé et François Aquin |
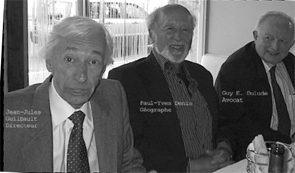 |
 |
| C. 50 : Jean-Jules Guilbault, Paul-Yves Denis et Guy-E. Dulude |
C. 50 : Gilles Lavigueur et Jacques Simard |
|
Conventum 1955
C’est au restaurant La Gaudriole, comme
d’habitude, qu’une trentaine de membres du
Conventum 55 se sont réunis, le 3 octobre
dernier, pour leur rencontre annuelle. Cette
année, c’est Robert Burns, le secrétaire du Conventum,
qui, généreusement, a bien voulu se
charger de l’organisation, aidé de Jean-Cléo
Godin et d’André Kuzminski. Le grand nombre
d’Anciens présents atteste incontestablement de
son sens de l’organisation bien connu (…)
Encore une fois, tous les participants ont
souligné combien il était agréable non seulement
de ressasser de vieux souvenirs, mais également de partager des expériences de vie.
Quel plaisir, par exemple, pour un amateur
d’opéra comme moi, de découvrir qu’Yvan
Whissel et Jacques Raîche partagent la même
passion et de pouvoir discuter avec eux des
oeuvres et des chanteurs que nous avons eu
l’occasion de voir et d’entendre! Cela nous
permet de découvrir de nouveaux aspects à des
visages que nous croyions bien connaître.
 |
 |
| C. 55 : Origène Grenier s.j., Louis Bernard et Jean Cléo Godin |
C. 55 : Yvan Whissell, Jacques Raîche et Jean-Guy Proulx |
 |
 |
| C. 55 : Claude Leblanc, Claude Leduc, Albert Melançon, Guy
Drouin et Jean-Denis Clairoux |
C. 55 : René Roy, René Doucet et Pierre Martin |
(…)Après un moment de recueillement pour
rappeler le décès de Raymond Vézina, d’Oscar
Dufresne et du père Gérard Delisle, s.j., j’ai
souligné que notre ancien professeur de Méthode,
le père Origène Grenier, s.j., qui nous
faisait encore une fois le plaisir de sa présence,
avait célébré le 15 août dernier son 60e anniversaire
de prêtrise. Tous se sont réjouis de constater que le père Origène semblait avoir trouvé la Fontaine de Jouvence et qu’il restait
aussi vif d’esprit que du temps du Collège.
Espérons que nous pourrons le compter parmi
les convives encore de nombreuses années.
Et après de joyeuses agapes, tous se sont
bien promis de se revoir l’automne prochain.
Nul doute qu’ils seront tous fidèles à leur
promesse, comme ils l’ont été cette année.
Louis Bernard, C. 55
|
Conventum 59
Les Anciens du C. 59 continuent d’être fidèles à leur rendez-vous annuel. Le rendez-vous
d’automne, bien pensé et organisé par notre
confrère Jacques D. Girard, a normalement
lieu dans ce «no man’s land» du calendrier qui
se situe entre la rentrée de septembre et les
Fêtes de fin et de début d’année. Les retrouvailles
2007 se sont donc déroulées le mercredi
14 novembre.
Nous étions, ce jour-là, 19 réunis à N.-D.-G.
chez Jacques D. pour l’apéro. Comme en témoignent
les photos qui accompagnent ce reportage,
nous en avons profité pour deviser
dans la bonne humeur sur nos devenirs respectifs,
tout en savourant ce moment privilégié qui
nous permet de nous revoir à intervalles
réguliers.
Cette rencontre, en particulier, a permis aux
deux cousins Laurendeau et Perrault de se retrouver,
eux qui ne s’étaient pas vus depuis
2000. Était également présent notre confrère,
le juge Marc Gagnon, qui avait fait le trajet
depuis Matane pour venir passer quelques
heures avec nous et ainsi pouvoir, tant qu’à
y être, siéger à Montréal. Les conversations,
joyeuses, animées et parfois sérieuses, se sont
ensuite poursuivies dans un restaurant de la rue
Sherbrooke Ouest autour d’un souper bien
arrosé des vins que chacun apportait pour
l’occasion.
Fait à noter, on retrouvait, parmi les 19 Anciens
présents, dix des 14 confrères qui se
voient plus souvent durant l’année au sein du
groupe Autour d’un piano. Les trois dernières
rencontres de ce groupe ont eu lieu respectivement à Montréal, chez François Cousineau; à
Repentigny, chez Renault Gaudet; et à Notre-
Dame-du-Portage, chez Michel Perrault. Ces
rencontres donnent lieu à des échanges qui
nous permettent de mieux nous connaître, par
exemple, en faisant écouter et en commentant
nos choix musicaux ou en parlant de nos oeuvres
de peinture préférées, deux des thèmes de
nos récentes réunions.
Michel Perrault, C. 59
 |
 |
| C. 59 : Marc Valois, Pierre Saint-Laurent et Pierre Angrignon |
C. 59 : Jacques D. Girard, Renault Gaudet, Roger Bourdages
et Jean Ruest |
 |
 |
| C. 59 : Pierre Duguay, Yves Laurendeau, Michel Perrault,
Jacques Vallée, Marc Gagnon et Pierre Saint-Laurent |
C. 59 : Jean Ruest, Jacques Grenier et Pierre Angrignon |
|
Conventum 62
C’est au splendide Restaurant Hélène-de-
Champlain que les Anciens du Conventum 62
se sont donné rendez-vous pour souligner, le
19 octobre 2007, le 45e anniversaire de leur
promotion. Le Conseil avait choisi cette fois
une réunion entre hommes, laissant les conjointes
seules à leurs occupations, afin d’avoir
les coudées franches pour se remémorer leurs
bons et mauvais coups. (…)
Nous arrivons donc au restaurant avec une
certaine appréhension bientôt remplacée par la
joie de retrouver les copains avec qui nous
avons partagé, sous la houlette de nos maîtres
jésuites, ces années d’apprentissage du latin et
du grec, d’initiation aux sciences, d’ouverture
au sens de l’histoire, et d’expériences formatrices
dans le théâtre, les sports, le scoutisme,
le journal et la vie politique.
Dans son mot de bienvenue, le président
Louis Fournier redit sa joie de nous revoir
aussi nombreux et, comme pour prendre la
mesure des années écoulées, lit une lettre du
Gray Rock’s Inn datée du 5 avril 1962 dans
laquelle on peut constater quelles dépenses
folles nous avons faites lors de notre fête de
Conventum. (...)
Michel Bourgault a rappelé que l’Association
des Anciens compte sur ses membres pour
assurer sa vitalité. Les Anciens du C.62 sont
sans doute nombreux à avoir pris leur retraite
depuis 5 ans. D’autres feront ce pas durant les
prochaines années. Il est important de songerà ce que l’engagement au service des autres
peut faire non seulement pour l’Association
elle-même, mais aussi pour son bien-être personnel.
Michel présenta ensuite un à un les artisans
et animateurs du site Internet de
l’Association. Une ou deux réunions par année,
un bon esprit d’équipe et les talents de chacun
habilement exploités suffisent pour faire fonctionner
le site.
Louis Fournier a mentionné, avec regret,
dans son mot de bienvenue, que quelques confrères
sont décédés depuis notre rencontre du
40e: Jean Blanchet, Normand Joyal, Ronald
Ferland et Jean-Pierre Bélanger. Ces départs et
bien d’autres signes nous donnent à penser
qu’il nous faut vivre intensément le moment
présent, en essayant de discerner, à travers lesévénements bons et mauvais de notre temps,
les signes d’un monde nouveau – espérons
meilleur! - qui se construit sous nos yeux
.
Michel Bourgault, C. 62 |
Remonter
Le Collège Sainte-Marie : aux origines du projet.
S’il est bien connu que le collège Sainte-Marie
a ouvert ses portes en 1848, le projet d’un collège
jésuite à Montréal remonte à bien plus loin
dans le temps, à une époque où il n’y avait
encore aucun établissement d’enseignement
secondaire à Montréal.
Dès le XVIIième siècle, sous le Régime
français, les Jésuites avaient tenté d’établir
un collège à Montréal. En 1693, le Père
Chauchetière entreprit d’y enseigner le latin, la
marine, les fortifications et les mathématiques à
un groupe de 12 à 15 élèves. Toutefois, ce collège
embryonnaire allait fermer avec le départ
de son initiateur en 1694. Ce n’est que vers
1727 qu’un groupe de citoyens montréalais
adressera au gouverneur Beauharnois une requête à l’effet de créer un collège destiné à
former les jeunes gens, et qui aurait été dirigé
par les Jésuites. Cette requête fut refusée par le
ministre Maurepas et une autre demande semblable
adressée en 1731 connut le même sort.
Pendant toutes ces années, les jeunes Montréalais
devaient donc se rendre à Québec pour
recevoir une éducation secondaire. Et il fallut
attendre jusqu’en 1773 pour qu’un nouveau projet
soit relancé. Hélas, cette même année 1773,
le Pape Clément XIV supprimait la Compagnie
de Jésus, et c’est aux Messieurs de Saint-
Sulpice qu’il reviendra d’installer leur collège
dans le château de Vaudreuil…
Par ailleurs, c’est aussi grâce à un monsieur
de Saint-Sulpice que s’amorcera plusieurs années
plus tard le retour des Jésuites au Canada,
et par la suite la fondation du collège. En 1839,
25 ans après que le Pape Pie VII ait restauré
la Compagnie de Jésus, le Supérieur du Séminaire
de Montréal, M. Vincent Quiblier, invite
le Jésuite Pierre Chazelle, recteur du Collège
St. Mary’s au Kentucky, à venir prêcher une retraite
sacerdotale à Montréal (M. Quiblier avait
eu le Père Chazelle comme professeur de Rhétoriqueà Montbrison). Le Père Chazelle accepteet se laisse convaincre pendant sa visite ici de
l’opportunité d’un collège jésuite à Montréal. Il
consent même à parler de l’idée au Général des
Jésuites et sera à Rome en 1841 au moment où
Mgr Bourget, nouvel évêque de Montréal vient
demander des Pères au Général des Jésuites, le
Père Roothan. Celui-ci acquiesce à la demande
de Mgr Bourget et charge le Père Chazelle de
recruter en France des Jésuites pour le Canada.
C’est ainsi que le Père Chazelle s’embarque le
24 avril 1842 à la tête d’un groupe d’ecclésiastiques
comprenant cinq autres missionnaires
jésuites, trois frères coadjuteurs et quatre prêtres
séculiers. Parmi ces pères jésuites figure le Père
Félix Martin, futur fondateur du collège. Le 31
mai 1842, les Jésuites sont de retour à Montréal,
42 ans après le décès du Père Casot, dernier Jésuite
arrivé au Canada sous le Régime français.
La fondation d’un collège jésuite est la priorité
du Père Chazelle et le premier choix qui lui
est proposé est de l’établir dans un collège qui
existait déjà, le Collège de Chambly. Mais
l’établissement est déficitaire, les communications
y sont difficiles pendant certaines périodes
de l’année et le Père Chazelle refuse. Entretemps,
le groupe des Jésuites qui logeait à
l’évêché de Montréal, alors sur la rue Sainte-
Catherine près de Saint-Denis, s’établit à
Laprairie dont le curé, l’abbé Power, vient d’être
nommé évêque de Toronto. Les habitants de
Laprairie se mobilisent alors pour convaincre le
Père Chazelle d’établir chez eux le collège
jésuite. Celui-ci est vite gagné à leur cause
et essaie, mais en vain, d’obtenir l’accord de
Mgr Bourget.
Finalement, Mgr Bourget renonce à confier
aux Jésuites le collège de Chambly où il entend
plutôt créer une école normale. Il a refusé aux
citoyens de Laprairie le collège qu’ils réclamaient
mais les assure tout de même que
les Jésuites continueront de leur prodiguer «leurs soins». À ce moment, c’est clairement àMontréal qu’il veut voir s’implanter un nouveau
collège jésuite. Il propose alors au Père Chazelle
de prendre en charge une école primaire située
près de l’église St-Jacques. Celui-ci s’y oppose,
gratuite en établissement payant.
Mgr Bourget et le Père Chazelle n’arriveront
pas à se mettre d’accord. Entretemps, le Père
Chazelle a été invité à prêcher des retraites
sacerdotales à Québec et à Toronto, ce qui lui
vaudra d’autres propositions. Mgr Turgeon de
Québec propose de confier aux Jésuites le collège
de Nicolet, tandis que Mgr Power souhaite
créer un collège à Toronto, et une mission
auprès des autochtones de Sandwich (Windsor).
Cette dernière proposition recevra l’assentiment
du Père Chazelle, en avril 1843. Enthousiasmé
par les missions auprès des «sauvages», il s’y
fixe lui-même en 1844 et y restera jusqu’à sa
mort survenue en septembre 1845.
Le départ vers Sandwich du Père Chazelle
oblige les Jésuites de Montréal à nommer un
nouveau Supérieur. Ce sera le Père Félix Martin
qui entre en fonction le 31 juillet 1844. Le projet
du collège jésuite à Montréal vient de franchir
une nouvelle étape (à suivre).
Bernard Downs, C. 59
Source : Desjardins, Paul : Le Collège Sainte-Marie de
Montréal
– La Fondation – Le Fondateur, Collège Sainte-
Marie, 1940. |
Remonter
Et les fameux bulletins ?
Bizarre quand même que cette obsession de la
mesure qu’illustre bien toute la pénible
querelle des bulletins. Comment savoir ce que
les enfants savent ? Jacqueline de Romilly
nous rassure : «(...) il n’est pas nécessaire que
les souvenirs remontent jusqu’à la conscience
pour exercer leur influence. Et voilà alors ce
monde intérieur qui se multiplie à l’infini,
grâce au trésor caché des souvenirs oubliés.
Une dimension nouvelle apparaît, et des
richesses nouvelles s’ouvrent à nous.»*
On ne peut mieux définir l’éducation humaniste.
Et malgré ce qu’en pensent les esprits
étroits, les choses qu’ils croient «apprises inu
tilement parce que si vite oubliées»... ne sont
pas oubliées: parce que «Les savoirs oubliés
sont passés en nous en éveillant certaines
émotions: la voie reste ouverte pour toujours à
des réactions de même type, affectives ou
morales»*.
Voilà bien ce que les bulletins scolaires ne
mesureront jamais...
Émile Robichaud
* Jacqueline de Romilly, Le Trésor des savoirs oubliés,Édition de Fallois, 1998, publié aussi dans Le Livre
de Poche |
Remonter
En Bref
Georges Leroux, C. 61, s’est vu décerner le prix de la revue Études françaises, pour son livre Partita pour Glenn
Gould, publié par les Presses de l’Université de Montréal. Ce prix s’accompagne d’une bourse de 5 000 $.
Louis Balthazar, C. 48, a été nommé officier de l’Ordre national du Québec. |
Remonter
Jacques Hébert, le rebelle aux multiples causes..
La fête du 150ième anniversaire fut probablement
une des rares apparitions de Jacques Hébert, à des
réunions de l’Association des Anciens. Il semblait
alors heureux d’y échanger avec ses collègues du
Sainte-Marie, et on s’étonnait un peu de le voir deviser
avec des confrères qui avaient largement passé
l’âge de la retraite, ce jeune à qui une vie d’engagement
avait donné une allure d’éternel combattant.
S’il était bien connu pour le soutien très actif et
constant qu’il apportait depuis des années aux organismes
qu’il avait fondés : Katimavik et Jeunesse
Canada Monde, pour les causes qui lui étaient
chères, telles la démocratie, les droits et libertés, ce
qui mérite largement d’être retenu est son association
au monde du livre à la fois comme écrivain et
comme éditeur.
 |
Jacques Hébert C.41 |
À la fin de ses études, Jacques Hébert entreprendra
de longs voyages de découverte à travers le
monde, dont il allait tirer des livres écrits d’une
plume alerte, dans un style vif et clair, révèlant un
homme déjà très attentif au monde qu’il découvre, et
devenus aujourd’hui objets de collection : Autour
des trois Amériques, Autour de l’Afrique, Aventuresautour du monde…. Ces expériences de voyage, en
lui ouvrant les yeux sur d’autres pays, d’autres cultures,
contribuèrent à faire de lui un homme profondément
engagé dans la lutte pour la liberté et la
démocratie. Le jeune écrivain critiquera la société
québécoise de l’époque duplessiste dans des publications
comme Vrai et Cité Libre. Il s’implique dans
l’édition pour publier son livre Coffin était innocent
refusé par les éditeurs de l’époque et fonde les Éditions
de l’Homme puis, quelques années plus tard,
les Éditions du Jour. Au cours de ces années turbulentes
marquées par la fièvre nationaliste et des
luttes politiques, Jacques Hébert allait éditer de
nombreux auteurs dont les opinions étaient souvent à l’opposé des siennes. Toujours, le respect de la
liberté et la fraternité qui transcendait les conflits
idéologiques et politiques préservait un climat de
respect mutuel entre lui et les auteurs.
On connaît généralement mieux le reste de sa vie,
la fondation de Jeunesse Canada Monde, de Katimavik,
ses activités comme sénateur, qui faisaient
de lui certainement le membre le plus turbulent du
Sénat. Jusqu’à la fin, il restera fidèle à lui-même,
bouillant, énergique ! S’il ne fut pas toujours indulgent
vis-à-vis ses anciens maîtres jésuites, comme
tant des plus célèbres élèves des bons pères, il
demeurera certainement l’un des plus fidèles à
l’esprit des Jésuites, par sa persistance à «travailler
sans chercher le repos, à combattre sans souci des
blessures».
Richard L’Heureux, C. 62
|
Remonter
Marcel Saint-Germain, le Cynique éclectique.
En 1998, la fête du 150ième anniversaire du collège
nous avait donné le plaisir de revoir sur la scène du
Gesù ce comique hors du commun que fut Marcel
Saint-Germain. C’était pour lui un retour aux
sources, sur les lieux mêmes où il était monté sur
les planches lors des mémorables soirées Parascos,
avec les Marc Laurendeau, François Cousineau,
André Dubois, Denis Arcand, Stéphane Venne,
Michel Provost et autres.
L’importance que le collège donnait aux arts d’interprétation
allait favoriser l’éclosion de ce grand
talent qui excellait dans le comique, comme dans
les autres genres de la scène. Mais ce sont ses
prestations lors des fameuses soirées Parascos, qui
allaient déterminer son parcours.
Au moment où il entreprend ses études de droit à
l’Université de Montréal, ses anciens confrères des
Parascos qui l’y avaient précédé montaient des spectacles
tels que le Ciné-Cabaret et Marcel les rejoindra
sur la scène. Il fait même une apparition dans le
film «Seul ou avec d’autres». De ce groupe de brillants
artistes venus de Sainte-Marie allait émerger
l’équipe des Dubois, Laurendeau, et Saint-Germain,
qui avec Serge Grenier, se produira pour la première
fois en 1961 au Centre social de l‘Université de
Montréal, sous le nom des «Cyniques».
 |
Marcel Saint-Germain, C. 58 |
Le succès fut tel que Marcel Saint-Germain qui
professe déjà comme avocat dans la firme PouliotMercure, décide d’embarquer à temps complet dans
l’aventure et quitte ce travail difficilement compatible
avec une carrière à la scène. Les Cyniques iront
de succès en succès pendant plus de dix ans. Aux
spectacles et émissions de télévision s’ajouteront
des disques et la participation du groupe au film de
Jacques Godbout, IXE-13. Dans toutes ces manifestations,
Marcel Saint-Germain fera valoir ses immenses
dons de comique naturel, aidé par une
remarquable voix de ténor. Sa capacité de dérider les foules s’appuyait sur une culture très étendue,
nourrie par des lectures abondantes et variées ainsi
qu’un grand appétit de connaître qui le mènera à une
maîtrise en sciences politiques une fois que les
Cyniques auront mis fin à leurs activités au début
des années 70.
Alors que les trois autres ex-Cyniques allaient
poursuivre leur carrière dans le domaine des communications,
Marcel Saint-Germain choisissait une
autre voie et entrait au service des communications
de Bell Canada. Après avoir pris sa retraite, il
retournera quelque temps dans l’univers de l’humour,
en devenant chercheur de talents pour le Festival «Juste pour rire» et entreprendra des études
en histoire de l’art. Son esprit fin servi par une
mémoire remarquable faisait de lui un homme au
commerce des plus agréables, regretté par ses amis
et collègues. Les Anciens perdent en lui un de leurs
plus attachants confrères.
Richard L’Heureux, C. 62,
avec la collaboration de
Marc Laurendeau, C. 57 |
Remonter
Passons sur l'autre rive (Marc
3,35)
Louis-Phillippe De Grandpré, C. 33, avocat,
juge à la Cour Suprême, bâtonnier de Montréal
et du Québec, président de l’Association du
Barreau canadien, décédé à Saint-Lambert
le 24 janvier 2008.
André Vigneault, C. 38, père spiritain, décédé
à Montréal le 6 janvier 2008.
Jacques Hébert, C. 41, journaliste, écrivain, éditeur, sénateur, mort à Montréal le 6 décembre
2007.
Georges-Henri Blouin, C. 42, diplomate,
décédé à Ottawa le 27 décembre 2007.
Roland Gougeon, C. 44, représentant commercial,
décédé à Montréal le 30 décembre 2007.
Jacques Leclerc, C. 45, prêtre séculier, décédé
à Montréal le 26 février 2008.
Paul-H. Giguère, C. 47, médecin pédiatre,
décédé à Montréal le 27 janvier 2008.
Léon Trudeau, C. 47, gynécologue-obstétricien,
décédé à Montréal le 25 décembre 2007.
Robert Pâquet, C. 48, psychologue, décédé à
Repentigny le 17 décembre 2007.
Pierre-Yves Toupin, C. 48, pharmacien, décédé
à Montréal le 21 janvier 2008.
Marcel Lapointe, s.j., C. 50, ancien professeur
d’art au Collège Brébeuf et au Centre de créativité
du Gesù, décédé à Montréal le 18 février
2008.
Marcel Lefebvre, C. 50, chimiste, décédé à
Shawinigan le 24 janvier 2008.
Robert Carle, C. 54, pédiatre, décédé à Montréal
le 2 avril 2008.
Yvon Gravel, C. 54, médecin-anesthésiste,
décédé à Montréal le 12 décembre 2007.
François-Michel Gagnon, C. 56, juge à la
Cour du Québec, décédé à Montréal le
4 mars 2008.
Michel Prud’homme, C. 57, médecin néphrologue,
décédé à Montréal le 14 mars 2008.
Gilles La Boissière, C. 58, professeur, décédé
à Montréal le 21 décembre 2007.
Marcel St-Germain, C. 58, avocat, politologue,
membre du groupe des Cyniques, décédé
à Brossard le 27 décembre 2007.
Pierre Leroux, C. 59, professeur, décédé
à Montréal le 9 mars 2008.
Gérard Boudreau, C. 65, directeur des
ressources humaines, décédé à Mississauga le
24 juillet 2007.
Robert Flahiff, C. 65, juge, décédé à Montréal
le 17 décembre 2007.
Jean-François Paulhus, C. 67, réviseur, décédé
à Montréal le 10 septembre 2007.
|
Remonter
|
| |
|
|